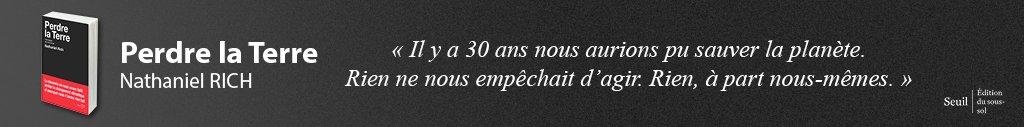La République et l’islam à l’épreuve des modernités
Ce n’est un secret pour personne que l’islam a du mal à se fondre dans le creuset républicain et laïc français. Un retour sur l’histoire des deux siècles passés permet de mieux en comprendre les raisons. L’origine coloniale de la politique musulmane de la France a suscité en réaction une défiance envers les valeurs auxquelles les musulmans de France sont invités à adhérer. L’Algérie offre la meilleure illustration de l’imbroglio auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. La question est posée du rôle joué par la modernité dans les entreprises de domination impérialiste comme dans les réactions qu’elles ont induites.
La République et l’islam en Algérie : un siècle de retournements
Entreprise sous le règne de Charles X, en 1830, pour redorer le blason d’une monarchie aux abois, la conquête de l’Algérie s’avèrera ensuite d’abord un projet défini par les élites politiques de la IIIe République acquises à la laïcité au courant du XIXe siècle. Rattachée à la France en 1834, l’Algérie des trois départements français (Alger, Oran, Constantine) illustre la tentative d’assimiler une colonie au territoire métropolitain et son échec final.
Le choc colonial a radicalement transformé l’islam. Mais ce fut d’abord sous sa forme traditionnelle, celle d’un islam pluriel imprégné de soufisme, que la religion majoritaire releva le défi du colonialisme ; il y eut ainsi l’épopée de l’émir Abdelkader contre les Français (1831-147).
Ce choc colonial a fait naître en réaction un mouvement réformiste musulman qui prônait un retour à l’islam des origines, pointant l’éloignement de l’islam des souverains musulmans comme cause de la faiblesse des pays musulmans face à une Europe conquérante. Les défaites militaires successives des mouvements inspirés de l’islam eurent pour résultat des divisions au sein du mouvement réformiste musulman. Tandis qu’une partie de ses protagonistes se faisait désormais les avocats d’une participation au jeu politique, avec une reconnaissance implicite du