Comparaître – sur Léviathan de Lorraine de Sagazan
La salle des Ateliers Berthier est en train de se remplir. Le spectacle commencera bientôt. Sur le plateau ouvert aux regards, les quelques spectateurs déjà assis contemplent une salle d’audience qui n’en est pas une. Il y a bien, d’un côté du plateau, une table où s’entassent des dossiers et des codes. Il y a bien, de l’autre, des chaises et un micro sur pied qui semble attendre les prévenus. Il y a bien un homme en habits de magistrat assis à la table et un autre, en civil, sur une chaise.
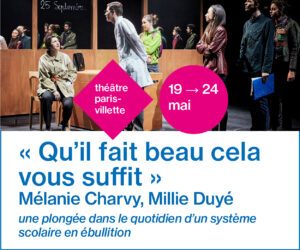
On ignore si ce dernier est un prévenu ou un simple spectateur, mais, d’où nous sommes, le premier a l’air d’un mannequin de cire. De la fumée qui recouvre le sol émergent des crêtes de terre noire – j’apprendrai en lisant la note de programme qu’il s’agit en réalité de fumier. Au plafond, une rosace en tissu translucide flotte au gré des mouvements de l’air. Les murs sont d’épais rideaux rouges ouverts à cour et à jardin sur les coulisses. En fond de scène, la figure du Léviathan de Thomas Hobbes est projetée sur un écran en ogive.
La scénographie produit un lieu impossible et composite, mélange de tribunal, d’église, de théâtre et d’écurie, où le sacré se superpose à l’excrémentiel et où la procédure judiciaire prend l’apparence d’une représentation théâtrale ou d’une cérémonie religieuse. Les deux hommes sur le plateau dessinent une opposition plus attendue entre le corps vivant-éprouvant du prévenu et le corps artificiel-mécanique du magistrat. Cette opposition se compliquera et se nuancera au cours du spectacle mais elle ne sera jamais défaite.
Léviathan met en scène trois cas de comparution immédiate, trois « histoires vraies » que Guillaume Poix a reconstituées et donc, précisément, écrites pour le théâtre. Ces cas sont devenus des scènes où des personnages interagissent dans un décor et sur un plateau. Cela n’enlève rien à leur valeur documentaire mais elle passe ici par le travail au long cours d’une écriture. Dans l’introduction de Léviathan (matériau), le li
