Sait-on réellement de quoi l’on parle lorsque l’on parle de « handicap » ?
Aujourd’hui, le plus grand nombre mobilise le terme « handicap » avec le sentiment de l’évidence partagée. Chacun d’entre nous sait, ou croit savoir, de quoi il parle lorsqu’il utilise le terme. Et cette évidence est inséparable de la conviction que si le handicap renvoie bien, dans une certaine mesure, à un problème de société (au vivre ensemble), il n’en reste pas moins avant toute chose une réalité de nature médicale et biologique (biomédicale) indiscutable.
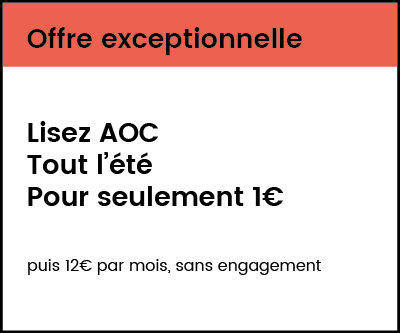
La recherche sociologique (en croisant histoire de la catégorie, analyses statistiques et observations des pratiques concrètes) met pourtant à mal l’ensemble de ces certitudes. Le handicap apparaît à l’analyse comme une invention politique et bureaucratique qui ne s’appuie sur aucun fait biomédical mais sur un ensemble de mécanismes sociaux liés au fonctionnement de nos grandes institutions sociales et à leur régulation.
Plus concrètement, ce que montre l’analyse sociologique, c’est que le terme « handicap » désigne en réalité toute personne dont la manière d’être et/ou de faire conduit à remettre en question le fonctionnement ordinaire d’une ou plusieurs de nos institutions, et que cette manière peut le cas échéant être lié à une différence biomédicale mais qu’elle peut aussi ne pas l’être du tout. Dire les choses en ces termes a de très nombreuses conséquences en ce qui concerne la manière d’aborder la question du handicap, de l’égalité ou de l’inclusion.
Le « handicap », une catégorie bureaucratique et politique
Le succès du terme « handicap » tient tout d’abord à son caractère flou. D’origine anglaise (hand in cap), il se diffuse progressivement, mais de manière parcellaire, en France au cours du XXème siècle au sein du langage courant. Son usage, relativement rare et métaphorique, renvoie aussi bien à des situations de compétition sportive qu’à des situations de détresse sociale, économique ou de santé. Il ne s’agit donc nullement d’un terme technique issu du champ médical ou médico-social. Son impositi
