Emilia Pérez et la « mexicanisation » de la France
Emilia Pérez raconte en musique l’histoire de Juan « Manitas » Del Monte, un chef de cartel de la drogue au Mexique qui décide de changer de vie et de devenir la femme qu’il a toujours rêvé d’être : Emilia Pérez[1]. Cette femme transgenre fonde ensuite une organisation pour soutenir les familles des personnes disparues à cause du trafic de drogue. À sa mort, Emilia Pérez devient un symbole de culte, d’espoir et de rédemption, au point d’être élevée au rang de sainte vénérée par le peuple. Depuis sa sortie en 2024, ce film s’est distingué par le contraste entre les nombreuses récompenses qu’il a gagnées dans des lieux iconiques tels que le Festival de Cannes, les Césars, les Golden Globes et les Oscars, et la controverse intense qu’il a suscitée en raison des critiques négatives et du rejet explicite de différents collectifs, en particulier au Mexique.
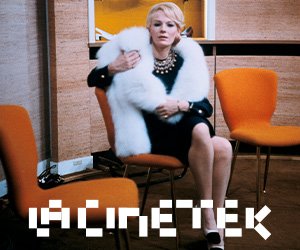
La polémique autour d’Emilia Pérez a mis en évidence de nombreuses questions sur son contenu. On a souligné la représentation stéréotypée du Mexique, l’utilisation maladroite et incorrecte de l’espagnol, l’approche rétrograde de l’expérience des femmes transgenres, la rédemption invraisemblable du personnage « Manitas » et le traitement irrespectueux de la question des disparu·es et des membres de leurs familles qui sont à leur recherche (notamment les madres buscadoras, ou « mères chercheuses ») au Mexique. Le scandale s’est amplifié avec la résurgence des commentaires racistes et islamophobes de l’actrice espagnole qui a interprété Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, les déclarations d’Audiard sur l’espagnol qu’il décrit comme une langue de « pays modestes, en voie de développement, de pauvres, de migrants », et une demande extraordinaire de la « Garantie Cinépolis » au Mexique pour ce film (dispositif commercial qui consiste à rembourser le spectateur si le film ne répond pas à ses attentes). À l’offense s’ajoute le fait que le film soit sorti d’abord dans de nombreux pays avant d’arriver dans les salles au
