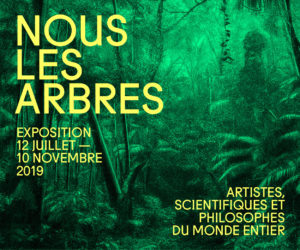Architecture : fulgurances et ennui chez Pascal Rambert
Inégalement intenses, les quatre heures de plongée dans les névroses d’une famille d’intellectuels et artistes viennois, sur fond de Mitteleuropa bourgeoise et de fascismes approchants, alternent bouleversantes confessions et monologues sentencieux – tous menés par une excellente troupe de comédiens. Trop bavarde, pas assez dégraissée, parfois complaisante, la pièce reste néanmoins passionnante dans sa volonté de mettre en scène le langage lui-même, d’en explorer les effets contradictoires, d’ausculter la capacité du verbe à détruire et à soigner, à tenter -en vain- d’empêcher la dislocation des êtres et des liens.
D’où la nécessité du ressassement infini : si la parole ne s’interrompt quasi jamais durant les quatre heures, c’est pour dire à la fois son échec et l’inépuisable refuge qu’elle représente. Les personnages ne cessent de dire et de redire, pour tenter de s’approcher sans cesse de ce qui se dérobe à eux – un avenir inconnu, une angoisse à circonscrire, un désir profond – faisant de la parole le lieu d’un pis-aller devant le vide, une tentative de parade à une époque à laquelle « ils ne sont pas préparés ». De sorte que c’est bien une « architecture », au sens d’un élément de construction qui protège (d’un « principe » (arche) et d’une « toiture » (tecton) : ce qui (re)couvre) qui manque à cette famille d’intellectuels autrichiens, que le magma de ses hostilités, frustrations et folies asphyxie.
Reprenant la trame classique de la discorde familiale, Architecture convoque l’atmosphère sclérosée d’une bourgeoisie à huis-clos chère à Buñuel
Rambert poursuit une geste inaugurée depuis Clôture de l’amour, celle qui raconte les luttes entre les êtres, et la façon dont le langage agit comme symptôme et cause de l’affrontement, le révélant et le déchainant à la fois. Ici, c’est le temps d’une croisière évoluant le long du Danube, croisant les villes de Zagreb, Sarajevo, Skopje, entre 1911 et 1938, jusqu’à l’année de l’Anschluss, que la famille d’Archite