Rhétorique et post-vérité
Il y a une légende noire de la rhétorique. Celle-ci provient avant tout d’une défiance ancienne envers l’art oratoire et ses puissances de séduction, dont les sources ne sont pas exclusivement philosophiques – même si, bien entendu, Platon en constitue un puissant orchestrateur. Mais il semble qu’elle connaisse aujourd’hui une actualité particulière, à l’heure où la discussion publique semble menacée par le règne de discours fondés sur la distorsion des faits et mis au service d’une stratégie de puissance et de domination.
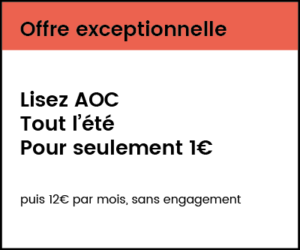
C’est ce que révèle l’inflation du concept de « fake news » et l’apparition récente de la notion de « post-vérité ». L’émergence d’une politique fondée sur le mensonge et l’indifférence proclamée à l’égard de la valeur fondamentale du vrai, y compris dans sa dimension purement factuelle, ne témoignent-elle pas d’un triomphe de la rhétorique ?
Discipline de la parole superbe et souveraine, l’art oratoire a souvent été soupçonné de perdre un certain sens du réel et de la vérité. Cela ne relève pas seulement des effets propres aux ressources puissantes de l’éloquence. Cela tient avant tout au risque d’une substitution : la parole s’institue en réalité autonome, par sa faculté de fasciner, de séduire, et peut-être de constituer une image trompeuse du monde.
La parole rhétorique serait donc une perte du monde, car elle se fait monde à l’écart et contre le vrai monde.
On reconnaît ici la dénonciation platonicienne de l’eikos, la « vraisemblance » de la parole oratoire, qui ne serait qu’une image et une ombre de la vérité, c’est-à-dire du monde intelligible. Cette polémique antirhétorique s’adosse à une critique plus générale de l’opinion, y compris dans son importance démocratique, dont Platon dévalue le caractère fragmentaire, provisoire et éminemment instable.
Mais une même défiance se tient également au cœur d’une certaine réflexion politique sur la séduction du discours rhétorique. On la trouve, spectaculairement déclinée, dans un passage de La Gue
