Réflexions autour des alternatives écolo-libertaires dans les mondes ruraux
Les événements liés à la pandémie de Covid-19 et sa gestion étatique coercitive ainsi que la visibilisation croissante de la crise écologique ont contribué ces dernières années à la revalorisation des campagnes françaises dans les débats publics. Un peu comme dans les années 1970[1], les mondes ruraux constitueraient désormais des espaces propices à des modes de vies sobres, écologiques, à l’écart des excès du capitalisme et des dérives gouvernementales en tout genre[2], des lieux d’inventivité et d’autonomisation politique.
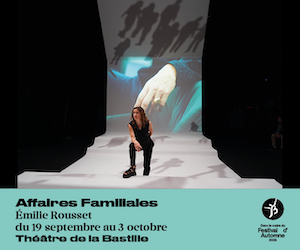
Cela s’inscrit d’ailleurs dans un moment historique où la politique institutionnelle semble largement désenchantée : la défiance des populations à l’égard du politique, de ses institutions et de ses élites est à son comble ; l’abstention est croissante (y compris lors des élections de premier ordre et au-delà des seules classes populaires) ; les promoteurs de la démocratie participative n’ont pas tenu leurs promesses ; les organisations politiques comme, dans une moindre mesure, syndicales n’ont pas bonne presse dans nombre de milieux sociaux. Mais ce scepticisme politique ambiant, voire cette résignation, ne signifient pas – il faut le redire – que les citoyennes et les citoyens soient dépolitisé·e·s ou désintéressé·e·s de la chose publique.
C’est dans ce contexte de crise de la représentation politique que se déploient, en France comme dans d’autres démocraties du Nord global, des pratiques politiques dites « préfiguratives »[3], notamment dans les mondes ruraux. Au-delà de leur diversité (expériences communautaires, éco-lieux, coopératives, réseaux d’interconnaissance, etc.), celles-ci consistent à mettre en œuvre diverses formes d’utopies « réelles »[4] ou concrètes, d’expérimentations égalitaires et écolo-libertaires, à travers des modes d’organisation collectifs souvent auto-subsistants et des relations sociales visant à moins d’asymétrie (sociale, de genre, de race, de générations ou autres), à la fois critiques des institutions
