Les linceuls – sur la 19e Biennale d’architecture de Venise
« Les architectes ont peur des machines, et ce depuis que l’ingénierie s’est détachée des dernières pages de Vitruve et s’est établie seule[1].»
Reyner Banham
«Ce ne sera certainement pas la Biennale des Tech Bros », annonçait Carlo Ratti, commissaire de cette 19ᵉ édition de la Biennale d’architecture de Venise, lors de son ouverture en mai. Dommage. Alors que l’humanité entre de plain-pied dans sa quatrième révolution industrielle, fallait-il vraiment l’esquiver ? Et qui mieux que Ratti, architecte-ingénieur à la tête du Senseable City Lab du MIT – l’un des laboratoires les plus influents sur les rapports entre ville et technologie – pouvait articuler un regard critique sur le sujet ? Cette non-posture est le défaut majeur d’une Biennale qui se refuse à nommer ce qu’elle met pourtant en scène : l’omniprésence des technologies numériques dans la fabrique future de l’architecture.
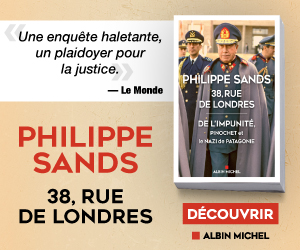
Ainsi, Ratti privilégie des voies détournées, un voyage en trois temps pour trois Intelligens : naturelle, artificielle et collective, dont on peine à comprendre l’articulation, si ce n’est que le bon sens de la première cautionnerait les délires de la deuxième, et que la troisième réduit l’humanité à une communauté privilégiée à la destinée progressiste : sauvée de l’emballement climatique terrestre par la technologie spatiale, promise à perpétuer l’espèce sur Mars. Ce récit, noyé dans la profusion des projets présentés (750 exposants) relève à la fois de la techno-épopée et de la stratégie d’évitement. Présenté sur le mode de la foire, l’exposition principale suit une allée centrale présentant les propositions d’architectes stars d’hier, bordée d’un catalogue de projets et d’expérimentations, actuels, plus modestes, souvent plus intéressants, mais rendus invisibles par leur nombre. Ce non choix curatorial interroge.
Car de quoi parle-t-on, au fond ? Antoine Picon, ancien collègue de Ratti au MIT, se montre plus direct : selon lui, « il n’y a pas de retour en arrière possible »
