De la faim coloniale à la souveraineté sacrée : penser l’affamement (2/2)
La faim, dans l’histoire des empires, n’a jamais été un simple effet collatéral. Elle fut, et demeure, un outil stratégique d’administration coloniale, de répression politique et de tri racial.
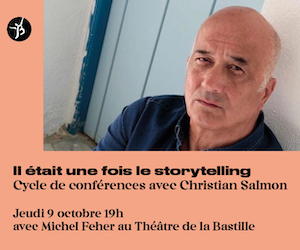
Du Bengale en 1943, où la politique britannique de réquisition des vivres combinée à un refus d’intervention humanitaire et à la poursuite des exportations, a provoqué une famine ayant causé plus de trois millions de morts ; à l’Ukraine des années 1932-1933, où le régime soviétique a organisé l’Holodomor en confisquant les récoltes, bloquant les déplacements et affamant délibérément les populations paysannes ; jusqu’à l’Algérie coloniale, où les famines à répétition du XIXe siècle ont été intégrées à une stratégie de conquête par épuisement, les populations autochtones étant recensées comme « bouches inutiles », selon une logique eugéniste avant la lettre – partout, les puissances impériales ont systématiquement utilisé la faim comme arme[1]. Parfois en la dissimulant derrière des catastrophes dites « naturelles », parfois en l’assumant comme prix politique de la domination.
Faim et modernité impériale
À ces exemples s’ajoutent d’autres épisodes majeurs : la famine irlandaise de 1845-1852, durant laquelle plus d’un million de personnes moururent tandis que l’Empire britannique poursuivait ses exportations de nourriture hors d’Irlande[2] ; la famine de Haïti sous embargo au début du XIXe siècle, résultant de la punition internationale de l’indépendance noire[3]. Cette sinistre généalogie de la faim administrée culmine et se technicise de manière radicale au XXe siècle. Elle trouve une expression bureaucratique et systématique dans le sort des ghettos juifs en Europe de l’Est, et tout particulièrement celui de Varsovie. Dès 1940, le régime nazi y instaure un blocus total et calcule scientifiquement les rations alimentaires pour maintenir la population dans un état de sous-vie avancée, programmant son extermination par la faim et la maladie bien avant la mise en œuvre
