La finance verte est-elle écologique ?
Depuis la conférence de Paris sur le climat en 2015, l’industrie financière multiplie les initiatives afin de se positionner comme un acteur incontournable de la lutte contre les changements climatiques. Labellisation des fonds d’investissement responsables, création d’instruments financiers à vocation environnementale, mise au point de stratégies de décarbonisation des portefeuilles : la finance passe au vert en promettant de mettre l’ingéniosité des banquiers au service de la cause écologique.
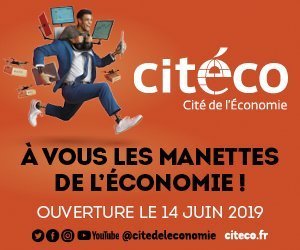
Pour un secteur dont la réputation reste très entachée par la débâcle des subprimes et la culture de l’excès qui y fut révélée, les développements récents de la finance verte fournissent une belle occasion de retrouver une légitimité auprès des décideurs et du grand public. Pour les plus sceptiques, cependant, une question demeure : l’innovation financière saurait-elle apporter une réponse adaptée aux défis environnementaux du XXIe siècle ?
La finance verte jouit à l’heure actuelle d’un soutien institutionnel considérable. Dans l’Accord de Paris sur le climat, la communauté internationale s’est engagée à rendre les flux financiers mondiaux compatibles avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques, reconnaissant à mots couverts l’incapacité des pouvoirs publics à assurer seuls les investissements requis pour la transition vers une économie durable et la nécessité d’enrôler le secteur privé dans cet effort de financement. Plusieurs mesures ont depuis été proposées afin de favoriser l’émergence de marchés financiers durables, dont la création, par la Commission européenne, d’un standard européen pour les obligations vertes et d’une taxonomie des projets éligibles à ce type de financement. En France, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a récemment lancé son label GreenFin pour les fonds d’investissement, tandis que l’AMF vient de créer sa Commission Climat et Finance durable, afin d’assurer le suivi des en
