Entreprise liquide et liquéfaction du travail
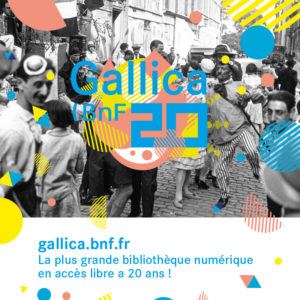
La démocratie a deux volets. Un volet libéral évidemment (liberté de penser, s’associer, contracter…), mais aussi un volet républicain qui ne l’est pas, comme le souligne Marcel Gauchet, avec le primat du suffrage universel, de la loi votée en son nom et de l’Etat pour la mettre en œuvre. Ce second volet est légitimé au nom d’une certaine représentation de l’intérêt général, conçu comme non réductible au jeu des intérêts particuliers, contrairement à ce que soutiennent les libéraux mais aussi les libertaires.
À y bien réfléchir, la même opposition vaut pour la façon de se représenter le travail et l’entreprise. Dans l’optique libérale, le travail est une marchandise et il existerait un marché du travail avec une demande des entreprises d’autant plus forte que le prix, le coût du travail, est faible. En cas de chômage, la solution coule de source : il faut supprimer ou réduire les structures intempestives (c’est pourquoi les libéraux parlent de « chômage structurel ») qui alourdissent ce coût (Smic, « charges socialesd », droit du travail…). Les sociaux-libéraux plaident pour une certaine forme d’intervention publique, avec les aides à l’emploi (la France en est la championne du monde depuis 1992). Mais la visée est identique, réduire le coût du travail. Le quinquennat de François Hollande – avec la loi El Khomri et le Pacte de responsabilité – et celui inauguré avec Emmanuel Macron par les Ordonnances Travail et la baisse de l’imposition sur le capital, ont au moins cet intérêt heuristique : faire comprendre qu’entre le libéralisme et le social-libéralisme, il y a certes des nuances, mais que l’essentiel – le sens de l’action – est commun.
À l’instar du travail, l’entreprise libérale doit être fluide, liquide. Elle est conçue comme un objet de propriété dont les performances doivent pouvoir être évaluées en permanence par les marchés boursiers libéralisés, ceux-ci étant supposés guider l’épargne vers les investissements les plus performants, assurant ai
