Les deux réformes des retraites : changement de système et changement de trajectoire
Celles et ceux qui se sont penchés sur la réforme à venir des retraites, ont dû en retenir quelques éléments saillants : « système à point », « âge d’équilibre », « système universel ». C’est en effet autour de ces mots que s’est faite la communication du Haut-Commissariat à la réforme. Ces termes ont l’avantage de fixer le débat. On construit sans peine des tables rondes, talk-show et éditos autour des problématiques suivantes : « Pour ou contre un système universel ? », « Pour ou contre les points ?», « Retraites : faut-il un âge d’équilibre ?».
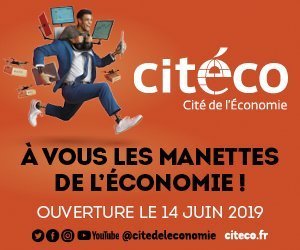
Ces questions ne sont pas vides de sens, mais cette façon d’aborder le sujet donne le sentiment désagréable qu’il s’agit d’un débat très technique, peu accessible. Et surtout, il mobilise la discussion sur un périmètre très restreint, assez loin des enjeux dominants de la réforme. Comme le rappelle souvent le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean Paul Delevoye, définir un système de retraite c’est faire un choix de société. Pourtant, on a bien du mal à saisir quel choix de société est associé à la réforme des retraites si on se limite au cadre du débat tel qu’il est posé par le gouvernement.
En revanche, si on applique, même de manière un peu schématique, les grilles de lectures de sciences sociales pour parler des retraites, on peut révéler assez simplement les enjeux principaux de la réforme à venir.
Changement de paradigme : du salaire continué à la pseudo-épargne
On peut, à gros traits, classer les modèles nationaux de retraites en deux catégories : des « systèmes à prestations définies » et des « systèmes à cotisations définies ».
Dans un système à prestations définies, la loi détermine à l’avance le mode de calcul de la retraite de chacune et de chacun, et même parfois un taux de remplacement (le rapport entre la retraite et le dernier salaire). Ce modèle conçoit la retraite comme un salaire continué.
Notre système de retraite actuel est dans sa conception un système à prestations définies : la
