Industrie du développement : les mésaventures des modèles voyageurs
Dans le monde de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, structuré par les institutions des Nations Unies, les banques de développement, les agences de coopération, les fondations, et une multitude d’ONGs petites et grandes, les interventions standardisées dominent. Élaborées par des experts internationaux, financées par les bailleurs de fonds, implantées par des organisations ad hoc (les « projets de développement ») ou par les administrations des pays bénéficiaires, ces interventions standardisées (sous forme de politiques publiques, de programmes, de projets, de protocoles) sont implantées de façon à peu près identique d’un pays à l’autre dans le Sud, et en particulier en Afrique.
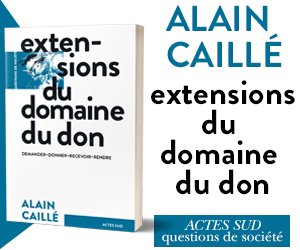
Micro-crédit solidaire, titrisation foncière, paiement basé sur la performance, transferts monétaires (cash transfers), prévention de la transmission du Sida de la mère à l’enfant, aliments thérapeutiques contre la malnutrition infantile, promotion des pratiques familiales essentielles, sont autant d’exemples contemporains, parmi bien d’autres, de « modèles voyageurs », promus, selon les cas, par la Banque mondiale, l’OMS, l’UNICEF, MSF, et bien d’autres « partenaires du développement ». Un modèle voyageur s’appuie le plus souvent sur une success story initiale quelque part dans le monde (comme le Brésil pour les cash transfers, le Rwanda pour le paiement à la performance dans le domaine de la santé, ou la Grameen Bank de Mohamed Yunus au Bangladesh pour le micro-crédit solidaire). Cette success story doit avoir été validée par des experts, certifiée par des institutions de développement, louée dans des médias spécialisés, avant de pouvoir devenir exportable.
Nous prenons ici « modèle » dans le sens très précis d’une configuration spécifique d’ingénierie sociale, un ensemble organisationnel composé de dispositifs intégrés autour d’un mécanisme causal censé induire des changements de comportements. Ce sens est donc très différent d’autres acceptions usuelles : modèle
