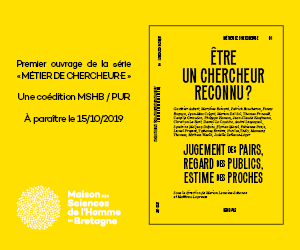Les arbres disent « nous »
Au cours des cinquante dernières années, une étrange révolution a définitivement et irrémédiablement modifié le paysage culturel européen. Cette révolution n’a rien à voir avec les innovations technologiques ; au contraire, elle est allée dans la direction opposée à ce que le progrès scientifique aurait dû et aurait pu encourager. On pourrait presque la voir comme la revanche des dinosaures – des espèces culturellement archaïques, que tout le monde considérait comme destinées à l’extinction, ont trouvé, comme magiquement, l’élixir inattendu d’une nouvelle jeunesse.
Ce qui s’est passé c’est que les institutions de production et de conservation du savoir se sont inversées : le musée et l’université ont chacun assumé le rôle et les attitudes de l’autre. D’une part, les musées, institutions liées avant tout à l’idée de culture entendue comme patrimoine à préserver, archiver et protéger, ont cessé de vouloir se concentrer sur le passé. Avec la naissance de musées publics et de fondations privées d’art contemporain – du MOMA à New York au Centre Pompidou à Paris, du Hamburger Banhof à, justement, la Fondation Cartier –, le musée est devenu l’institution dont la tâche principale est celle d’ordonner le présent, ou plutôt d’isoler dans le présent les tendances qui révèlent un avenir toujours imprévisible.
Les musées ont su mieux interpréter le présent que les universités. La clé réside dans la forme « exposition ».
Le mérite, évidemment, n’est pas seulement celui des musées : c’est l’art lui-même qui, depuis qu’il a décidé d’être et de se définir contemporain, a institutionnalisé l’avant-garde et est devenu la force avec laquelle une société essaie de s’imaginer différente de ce qu’elle est. Ce n’est plus le reflet parfait, l’image au miroir, d’une culture ou d’une société donnée, mais au contraire la tentative d’une société de devenir autre et méconnaissable, de s’émanciper de sa propre histoire présente et passée. L’art, en effet, est contemporain non pas parc