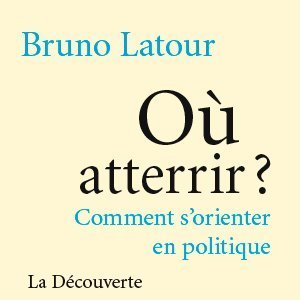Vers une archéologie du capitalisme
On ne saurait bien entendu parler de « post-capitalisme » * sans questionner brièvement la nature du sens exact à accorder au préfixe « post- ». Que signifie donc le fait de venir après quelque chose ? Au moins deux cas de figure assez différents peuvent se présenter. En parlant de scénario « post-apocalyptique », de syndrome « post-traumatique » ou d’atmosphère politique « post-9/11 », on désigne un état de fait qui a été initié par un événement (un effondrement sociétal ou psychique, les attentats d’Al Qaeda du 11 septembre 2001), dont on étudie le déploiement ultérieur. En parlant d’œuvres « post-romantiques » ou de législations « post-apartheid », on désigne en revanche plutôt un état de fait qui s’est clos à la fin d’une période désormais révolue. On ne saurait bien sûr esquiver la question de savoir laquelle de ces deux acceptions est plus adaptée à la réouverture d’un horizon « post-capitaliste ».
Du remplacement à la superposition
À première vue, l’effort pour penser le « post-capitalisme » implique la croyance en la possibilité de sortir du capitalisme, de le dépasser comme on accélère pour dépasser une voiture trop lente qu’on laisse derrière soi, afin d’entrer dans un autre régime, différent de lui, une « autre chose » dont on espère implicitement qu’elle le remplacera avantageusement. Il semble toutefois plus judicieux de penser les « post- » comme désignant l’inertie d’une persistance autant que la clôture d’une fin.
On pourrait en trouver un modèle dans les références actuelles au « post-colonial ». Ce que l’on vise par là, ce n’est pas tant le fait que la colonisation ait pris fin, une bonne fois pour toutes, avec pour corollaire que nous vivrions depuis lors dans des relations géopolitiques totalement nouvelles n’ayant plus rien à voir avec l’époque coloniale officiellement révolue. C’est plutôt le fait que, tout au contraire, les relations géopolitiques qui ont succédé aux indépendances nationales continuent à subir les inerties des rapp