Sectes : la fin de l’exception française
23 décembre 1995. Toutes les chaînes de télévision diffusent les images des corps des adeptes de l’Ordre du Temple Solaire. Dans une scénographie macabre, les 16 membres sont disposés en étoile au milieu d’une clairière, dans un recoin du massif du Vercors. Les heures qui suivent apportent d’autres révélations. On apprend rapidement que les corps ont été carbonisés au lance-flamme, puis que des enfants font partie des victimes. Le surlendemain, une information circule selon laquelle certains ont été abattus d’une balle dans la tête. Elle sera confirmée, le suicide collectif prenant les allures d’un meurtre de masse.
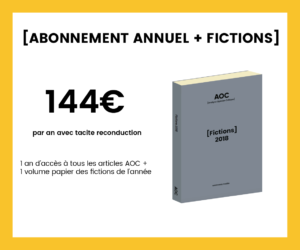
9 janvier 1996 : le Premier Ministre Alain Juppé annonce un train de mesures, toutes destinées à prendre en charge au sommet de l’État cette « menace sectaire ». La réaction n’est pas seulement rapide, elle est aussi un remarquable revirement par rapport à la situation qui prévalait jusqu’alors. La mise en place d’une politique nationale était en effet une demande régulière des associations antisectes depuis plus de vingt ans, mais ces demandes étaient refusées systématiquement. Tout change dans les mois qui font suite au massacre. Un observatoire des sectes est alors mis en place auprès du gouvernement, qui sera remplacé en 1997 par un puissant organisme doté de pouvoirs inédits : la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS), dont la MIVILUDES, fondée en 2002, est l’héritière.
Une politique exceptionnelle
Ainsi se met en place une politique exceptionnelle. Dans les années qui suivent, les associations antisectes obtiennent le statut avantageux d’association d’utilité publique, et les services de l’État sont orientés vers la surveillance du « phénomène sectaire ». Des cellules de prévention sont installés au sein de chaque département, sous l’autorité des préfets. Des formations sont organisées au sein de différents ministères ou à l’école de la magistrature. Des cours d’éducation civique viennent attirer l’attention des adolescen
