Sexe, sexualité et pouvoir médical
Le 8 octobre, lors du vote, en première lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique, l’Assemblée nationale a inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 2131-6 consacré aux « enfants présentant une variation du développement génital ». Cette périphrase désigne les enfants dont les caractéristiques sexuées (chromosomiques, gonadiques, génitales, etc.) ne permettent pas l’identification classique comme femelle ou mâle et que l’on appelle couramment des enfants intersexués.
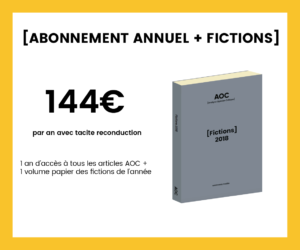
Le nouvel article se limite cependant à prévoir les modalités de prise en charge de ces enfants par des centres spécialisés ; il ne formule aucune interdiction des traitements hormonaux ou chirurgicaux irréversibles destinés à faire disparaître l’intersexuation en corrigeant les corps. Agnès Buzyn, ministre de la santé, a jugé préférable « de laisser aux médecins le soin de définir ce qui relève ou non d’une nécessité médicale ».
Une double tribune, publiée le 5 juillet dans les colonnes du Monde et intitulée « Faut-il opérer les enfants intersexués ? », annonçait déjà les termes du débat parlementaire. D’une part, 17 signataires dénonçaient les traitements d’assignation « à des idéaux types d’hommes et de femmes, dans une sorte de fiction médicale qui voudrait que la conformité anatomique soit nécessaire à l’éducation dans une catégorie [de sexe] ou dans l’autre ». D’autre part, 24 signataires, renforcés de 116 cosignataires, défendaient de telles pratiques.
Le contraste ne frappait pas seulement par le déséquilibre numérique, mais aussi par les qualités des protagonistes et la teneur de leurs discours. Les 140 signataires et cosignataires étaient des médecins ou d’autres professionnels de santé, la quasi-totalité de l’avant-garde des 24 premiers signataires étant composée de professeurs de médecine. Leurs 17 opposants étaient, pour la plupart, étrangers au monde médical, réunissant politiques, universitaires, avocats, responsables associatifs, etc. Les uns invoquaient leur « ex
