Avenirs jaunes, un an plus tard
Où en sont les gilets jaunes ? Que deviennent-elles, que fabriquent-ils depuis les six derniers mois, depuis qu’ils paraissent moins visibles ? Et que feront-ils pour le premier « anniversaire » du mouvement, dans quelques jours ? Un nouveau mouvement social va-t-il surgir ? Et, à plus long terme, quelles seront les conséquences de leur mobilisation ?
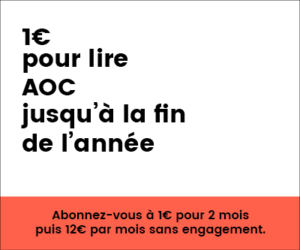
Toutes ces questions agitent depuis quelques mois l’opinion, les médias, la classe politique et la population française. Il est d’autant moins aisé d’y répondre que l’étude des effets des mouvements sociaux pose, en règle générale, de redoutables difficultés. L’enquête sur les protestations a souvent privilégié leur amont et leur déroulement au détriment de leurs suites. Les chercheurs, comme les témoins, ne débattent-ils pas encore aujourd’hui des conséquences des événements de mai-juin 68 sur la société française ?
L’embarras du diagnostic est bien entendu redoublé dans le cas d’une protestation inattendue qui, comme celle des gilets jaunes, n’a pas épousé les conventions des mouvements sociaux de son époque, s’est développée en dehors des formes d’action et des circuits institutionnels connus et s’est donc écartée de facto des régularités observables par l’historien ou le sociologue des mouvements sociaux.
Débouchés électoraux ?
Face à ces difficultés, une réduction fréquente de la question consiste à n’envisager que les effets électoraux de la protestation. On sait que les dernières élections européennes de mai 2019 auront apporté peu de succès aux listes du chanteur Francis Lalanne et du leader jaune Christophe Chalançon, explicitement formées en référence au mouvement, puisqu’elles n’auront totalisé à elles deux que moins de 0,6 % des suffrages exprimés soit environ 125 000 voix. Quelques leaders jaunes locaux ou nationaux isolés avaient quant à eux rejoint au printemps dernier Debout la France, Les Patriotes, ou le Parti communiste français, mais cela ne leur pas porté chance non plus.
Plusieurs partis espèrent
