L’animal et le social : vers une révolution zooanthropologique ?
Une révolution invisible, qui touche le monde social et qui a trait aux nouvelles relations entre humains et animaux, est en cours. L’importance de cette révolution tient au fait que nous sommes entrés dans des sociétés qui ont accepté progressivement non pas seulement d’avoir des échanges avec les animaux, comme ce fut toujours le cas, mais plus fondamentalement de se laisser transformer par l’ensemble des interactions entre vivants humains et vivants non-humains.
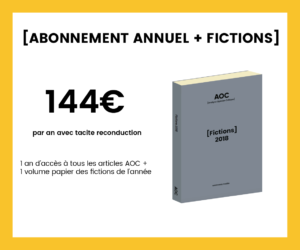
Cette profonde transformation socioculturelle souligne toute la différence entre relations et interactions. Une relation sociale interspécifique qui en reste à un échange dominé par l’humain ne peut venir perturber et transformer ce même échange social dans la mesure où elle se vit du seul point de vue humain. Or la révolution dont nous parlons ici échappe aux deux obstacles qui avaient empêché jusqu’à maintenant la réciprocité des échanges entre espèces : l’anthropomorphisme et l’anthropocentrisme. De telles interactions interspécifiques au contenu foncièrement éthique nous font entrer dans une expérience inouïe du social.
L’entrée en crise des relations sociales de type anthropocentrique.
La révolution sociale qui est en cours de manière presque invisible est fondamentalement une étape nouvelle mais inédite dans les relations entre les humains et les animaux. Elle peut se résumer à une forme radicalement nouvelle de sensibilité à l’égard du vivant. Les causes qui expliquent la naissance de cette nouvelle sensibilité à l’égard du monde animal sont multiples mais peuvent être ramenées aux deux plus essentielles : un nouveau rapport à la nature provoqué par la crise écologique majeure que vit la terre et un sentiment généralisé qui se traduit par une conscience exacerbée de la finitude du monde et de la vie.
Il existe incontestablement un nouveau rapport à la nature provoqué par la crise écologique actuelle à l’issue entièrement incertaine. C’est pourquoi la révolution sociale qui est en cours et qui est
