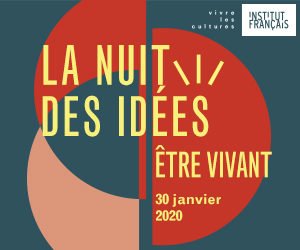La fin du cycle néolibéral et le retour des États-nations
Les quarante années de transformations économiques, technologiques et sociales qui viennent de s’écouler et que l’on pourrait ressaisir sous le chef, nécessairement trop englobant, de « cycle néolibéral », doivent faire l’objet d’un inventaire que je me suis efforcé de dresser récemment (voir Slow Démocratie, Allary éditions). Ce cycle néolibéral a largement désarmé la puissance publique (le kratos de la démocratie), c’est-à-dire ces armatures politiques, institutionnelles, juridiques qui donnaient au souverain (quel qu’il fût) du pouvoir sur soi et sur autrui. L’abondante littérature relative à la crise de la démocratie ces dernières années, insiste pourtant trop sur les difficultés du demos et passent sous silence la crise du kratos.
Trois traits me semblent caractériser le cycle néolibéral des années 1975-2016 : d’abord la globalisation économique et financière, matérialisée par l’ouverture croissante des économies nationales, de 10 % à 30 % en moyenne en quelques années, qui disqualifie toute politique macroéconomique volontariste « dans un seul pays » : le Premier ministre britannique James Callaghan en fait les frais dès 1976 ; les socialistes français aussi en 1981. Dans un environnement macro-économique globalisé, la macroéconomie keynésienne auto-centrée s’avère inopérante. Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a « pas d’alternative », mais j’y reviendrai.
Deuxième trait, la révolution technologique qui démarre à partir des années 1990 et dont le principal effet est d’accélérer la globalisation. Internet fait drastiquement baisser les coûts de coordination entre entreprises et facilite l’essor d’un système financier globalisé très intégré. Il en résulte une fragmentation des chaînes de valeur industrielles qui deviennent de plus en plus mondialisées. Cette révolution technologique qui se poursuit avec le développement de l’intelligence artificielle n’est pas sans effet sur la structure sociale dans les pays industrialisés. D’abord parce qu’elle accé