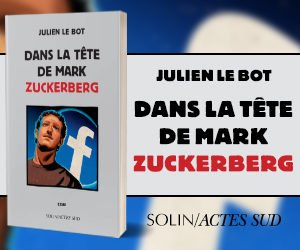Ghetto Biennale en Haïti : chronique d’une révolte annoncée
En dépit d’une crise socio-politique dont nul ne saurait présager l’issue en Haïti, la 6e Ghetto Biennale a débuté ce vendredi 29 novembre à Port-au-Prince. Jusqu’à la dernière heure, la tenue de cette manifestation artistique s’est avérée incertaine. Dans un contexte insurrectionnel et d’immense fragilité nationale, ses cofondateurs, André Eugène et Leah Gordon, ont choisi de maintenir une programmation dont la pertinence se révèle aujourd’hui des plus troublantes.
Consacrée à l’héritage révolutionnaire de la République haïtienne, la 6e Ghetto Biennale voit ses préoccupations théoriques débordées par la réalité d’une vaste révolte populaire et par la brutalité des moyens déployés pour la contenir.
Peyi lòk
Dévorée par les inégalités sociales, Haïti apparaît aux yeux du monde comme une nation à bout de force. Laissée exsangue par des décennies de prédations privées, qu’elles soient locales ou étrangères, son agonie a depuis longtemps pris des airs de normalité.
Aussi, rien n’est venu alarmer l’opinion internationale lorsque, avec le Peyi lòk, le pouls de la vie haïtienne n’a plus semblé osciller qu’entre signes de mort clinique et pics combatifs de survie. En février 2019, cette opération contestataire de blocage du pays s’est mise en place pour contraindre le président Jovenel Moïse à la démission. Malgré les graves accusations qui entachent son mandat, celui-ci était resté sourd aux mouvements de protestation qui depuis 2018 emplissaient régulièrement les rues d’Haïti.
Comme quatre de ses prédécesseurs, plusieurs membres de son gouvernement et une part des tutelles occidentales du pays, Moïse est impliqué dans l’affaire PetroCaribe. Entre 2008 et 2016, ce colossal détournement de fonds public aurait privé le peuple haïtien de 3,8 milliards de dollars issus d’un ambitieux plan de coopération avec le Venezuela et destinés au développement d’équipements publics et de projets sociaux[1].
Alors que l’écrasante majorité de la population haïtienne est soumise