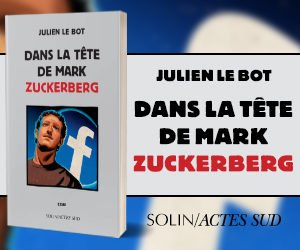Un homme qui meurt – à propos de Je reste roi de mes chagrins de Philippe Forest
Après le Londres de Peter Pan dans L’enfant éternel (1997), Philippe Forest renoue dans son dernier roman avec l’Angleterre où il a vécu. Dans ce roman inaugural, il explorait des figures de poètes à la paternité endeuillée, Victor Hugo et Stéphane Mallarmé, afin d’y chercher des repères pour ce dont il faisait lui-même l’épreuve. Dans Sarinagara (2004), le maître du haïku Kobayashi Issa et l’inventeur du roman moderne japonais Natsume Sôseki rejoignaient cette compagnie. Quinze ans plus tard, le romancier ajoute la figure de Winston Churchill à cette galerie de pères orphelins d’un enfant, dont les accomplissements qui les ont rendus célèbres ont masqué cet événement majeur, pourtant impérieux dans leur vie intime.
Churchill est revenu récemment sur le devant de la scène culturelle, avec le film de Joe Wright Darkest Hour (USA, 2017), et la série télévisée britannique de Peter Morgan créée en 2016 pour Netflix, The Crown. C’est d’un épisode de celle-ci que Philippe Forest tire l’argument de son roman – fait qu’il révèle très tardivement dans le cours de celui-ci, comme si le roman n’était presque qu’un long suspense vers cette révélation. La scène principale du roman, vers laquelle tout entier il gravite, est ainsi la fameuse série de séances de pose de Churchill pour le peintre Graham Sutherland, commandité pour faire le portrait du grand homme à la fin de sa carrière, afin de couronner celle-ci mais aussi, moins généreusement, de lui signifier son congé.
L’écrivain cependant en fait la scène de la réminiscence d’un deuil, un deuil de père qui fut non seulement celui de Churchill, mais celui aussi du peintre Sutherland. Le roman repose sur l’axe de cette étrange coïncidence, qui frappe le narrateur en ce qu’elle vient confirmer pour lui l’image, à laquelle il croit fortement, de ce que la vie d’un autre dit aussi bien la nôtre : « Cette histoire, je l’ai naturellement reconnue comme étant la mienne. » (p. 202)
Selon cette logique de redoublement, de re