De l’indifférence à l’exécution des crimes de masse : l’ordinaire des génocidaires
Du djihadisme contemporain aux Einsatzgruppen nazis en passant par les génocidaires hutu, les bourreaux khmers rouges, ou encore les ultra nationalistes serbes…. on a trop longtemps cherché à expliquer le comportement des exécutants des exterminations de masse à partir des idéologies qui les habitaient. Mais tous ne furent pas des idéologues convaincus. Nombreux n’ont jamais lu la moindre ligne de propagande, bien trop fastidieuse à leur goût. La plupart ne percevaient que les rudiments de la rhétorique de la « beauté de la purification ».
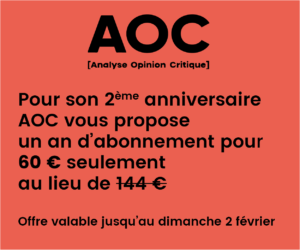
Et pourtant, tous tuèrent, avec plus ou moins de passion, plus ou moins d’enthousiasme, parfois avec cynisme ou sadisme, mais rarement avec remords. Pour certains, il s’agissait d’appliquer les ordres à la lettre en se soumettant docilement. Pour d’autres, il s’agissait d’anticiper ces mêmes ordres pour se faire bien voir, alors que d’autres cherchaient toujours un moyen d’en faire le moins possible, histoire de ne pas trop se fatiguer.
Des hommes ordinaires, pour la plupart, a-t-on pris l’habitude de dire. Mais finalement que recouvre cette idée d’homme ordinaire héritée de la pensée de Hannah Arendt, quelle valeur heuristique peut on lui accorder aujourd’hui pour comprendre comment des hommes que rien ne semblait prédestiner à devenir des tueurs, assassinèrent pourtant, et sans grandes hésitation, des centaines voire des milliers d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants sans défense ?
Pendant des années, les recherches, les commentaires et les plaidoiries sont restés focalisés sur les seules conditions ontologiques qui feraient qu’un homme réputé ordinaire puisse tuer à la chaîne d’autres hommes. En interrogeant ainsi cette capacité que les hommes auraient dans certaines conditions de commettre de tels crimes, les différentes conceptions sont restées tributaires d’une approche quasi juridique portant sur l’acte lui-même, ses motivations, voire ses circonstances atténuantes.
Dans la vie quotidienne d’un exécuteur, la mo
