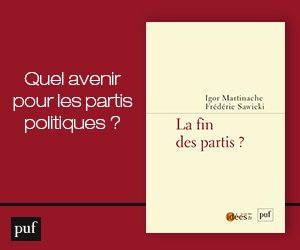À quelle époque vivons-nous ?
La parution récente de l’ouvrage collectif Les Noms d’époque. De « Restauration » à « Années de plomb » dans lequel 14 historiens et historiennes s’attachent à élucider 14 noms du temps contemporain, invite à s’interroger en contrepoint sur nos difficultés, voire notre incapacité, à donner un nom à notre propre temps. La chose n’est en soi pas très étonnante. « Ce n’est qu’en quittant une chose que nous la nommons », déclarait Gide dans une conversation avec Walter Benjamin[1]. L’ouvrage montre pourtant que certains chrononymes surgissent in medias res, dans l’effervescence des moments qu’ils entendent désigner. Ce fut le cas de « Restauration », enjeu de luttes et de pouvoir dans les années qui suivirent l’abdication de Napoléon, du Risorgimento italien, de l’âge victorien, de la fin de siècle ou encore des Années de plomb qui marquent la décennie 1970 en Italie.
Mais encore faut-il que l’expression soit utilisée et « prenne » dans le discours public. Mark Twain et Charles Dudley Warner eurent beau proposé la notion de Gilded Age pour qualifier les Etats-Unis de la fin du XIXème siècle – The Gilded Age : A Story of Today, 1873 –, ce n’est vraiment que cinquante ans plus tard que l’expression fit souche sous la plume d’historiens et d’intellectuels « progressistes ». C’est sans doute pourquoi le plus grand nombre des noms d’époque sont « exogènes » : forgés et diffusés après la séquence qu’ils désignent, porteurs de ce fait de lectures rétrospectives, parfois nostalgiques, parfois accusatrices, mais toujours anachroniques.
Ainsi des « Belle Époque », « Roaring Twenties », « entre-deux-guerres » ou « Trente Glorieuses ». Nommer son propre temps suppose en effet une assez vive intelligence de l’instant. Prendre la mesure des événements que l’on vit, en évaluer la portée, comprendre dans quelle séquence ils s’inscrivent, comme ils font et feront sens, voilà qui peut décourager l’observateur le plus avisé. La plupart préfèrent donc s’en remettre à demain.
On