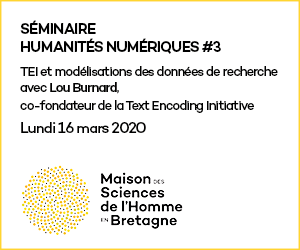Aux armes citoyens ? Violences du pouvoir et pouvoir de la violence au Cameroun
Le 14 janvier 2020, au Lycée de Nkolbisson, dans une proche banlieue de Yaoundé, l’enseignant de mathématiques Boris Kevin Njomi Tchakounté est poignardé à mort par un de ses élèves. Le 30 janvier 2020, des milliers de ses collègues enseignants et d’élèves qui étaient venus à la levée de son corps au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, question de rendre un dernier hommage au disparu, sont dispersés aux jets d’eau et au gaz lacrymogène. Nombre d’entre eux sont arrêtés, matraqués avant d’être libérés plus tard.
On se souvient qu’en novembre 2016, des avocats et des enseignants des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont entrés en grève pour des revendications essentiellement professionnelles. Les avocats réclamaient la traduction des actes OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et la restauration de la pratique du Common Law dans les deux régions. Les enseignants quant à eux, protestaient contre ce qu’on a appelé la « francophonisation » progressive de l’enseignement dans les régions anglophones. Alors que le gouvernement fait semblant de négocier pour résoudre la crise, les forces de l’ordre répriment violemment et mortellement les manifestants. Les deux régions s’embrasent et depuis bientôt quatre ans, le pays est en état de guerre civile, des anglophones revendiquant désormais la sécession et la création d’un État à part, la république d’Ambazonie, constitué des deux régions anglophones actuelles. On compte des milliers de morts de part et d’autre, d’innombrables déplacés internes et externes et une économie régionale totalement sinistrée.
Les deux événements ci-dessus ne sont point liés. Toujours est-il qu’ils révèlent, comme de nombreux autres qu’on pourrait citer, un pouvoir qui écoute à peine les doléances de ses gouvernés mais dont l’instinct répressif est on ne peut plus aiguisé. Vers la fin de son essai sur la violence en situation coloniale, Frantz Fanon cite Les Armes miraculeuses d’Ai