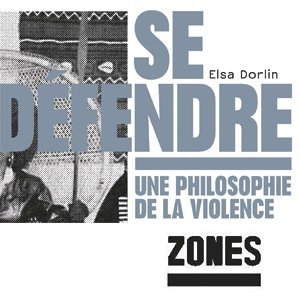Commémorations nationales : les limites de la mémoire
Charles Maurras a été récemment jugé « commémorable » par le Haut Comité des commémorations nationales du ministère de la Culture, puis retiré, par la ministre Françoise Nyssen, de ce petit panthéon de papier qu’est le Livre des commémorations nationales. Dernier rebondissement : dix des douze membres du Haut Comité ont, en réaction, décidé de démissionner. Seul le nom de Maurras avait émergé, dans le débat public, de l’inventaire numérologique des faits et hommes retenus par le Haut Comité pour cette année en « 8 ». L’antisémite et nationaliste Maurras aura ainsi été préféré au croisé pourfendeur des hérétiques albigeois Simon de Montfort (1218), à l’aventurière Alexandra David-Néel (1868), au libertin Bussy-Rabutin (1618). Il l’aura emporté aussi sur ces choses plus familières aux Français qu’avait pointées le Haut Comité : les Fables de la Fontaine (1668), l’armistice du 11 novembre (1918) ou peut-être les Jeux Olympiques d’hiver à Grenoble (1968, un peu avant mai). On peut profiter de la polémique pour grappiller quelques connaissances sur le nationalisme à la française, ou bien s’affronter sur la fonction des commémorations : célébrer des héros ou des « justes » ? Déplorer des tragédies ? Évoquer des figures discutables ? Pas une semaine d’ailleurs sans que la question de ce dont il convient de se souvenir collectivement ne fasse l’objet de controverse.
Réjouissons-nous qu’il y ait débat ! Constatons toutefois que l’affrontement ne sort pas des cercles fermés des professionnels de l’histoire (intellectuels, universitaires, académiciens, conservateurs du patrimoine) et des politiques prompts à en faire bon usage. Interrogeons-nous surtout sur le consensus que révèlent ces polémiques entre intimes. Derrière leurs apparents affrontements, les différentes parties en présence semblent en effet partager une conviction : s’ils s’impliquent avec enthousiasme et colère dans la polémique sur la « commémorabilité » de Maurras, c’est qu’ils s’accordent sans dout