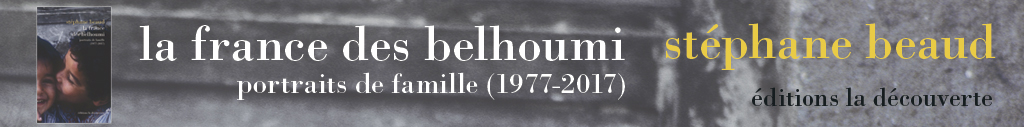La finance contre le capitalisme ?
Et si le post-capitalisme* devait venir de là où on l’attend le moins ? Et s’il était déjà en train de surgir du cœur même du monstre, depuis les rangs enfiévrés de cela même qui le fait surchauffer depuis quelques décennies, mais qui le travaille et le met périodiquement en crise depuis ses tout débuts, à la fin du XVIIe siècle ? Et si c’était dans les arcanes de la finance que prenait d’ores et déjà forme l’un des replis constitutifs du post-capitalisme ? Toute une série de penseurs (post ?-)marxistes, les plus stimulants parce que les plus hétérodoxes, se sont en effet retrouvés récemment autour d’une analyse croisée de la notion de produits dérivés (derivatives) qui mérite de retenir toute notre attention.
Aberrations et dérivations financières
L’argument est complexe, surprenant, mais stimulant. Réduit à sa formulation la plus succincte, il prend la forme d’un retournement, à interpréter comme un repli. La gauche bien-pensante dénonce (non sans raison) les produits dérivés comme le parangon de l’aberration financière dévoyée, autonomisant « la folie spéculative » aux dépens tragiques de « l’économie réelle ». Ces mêmes produits dérivés se trouvent toutefois tramer en sous-main une « logique sociale » tissant du lien entre des réalités hétérogènes, que nos modes de collaboration attachent les uns aux autres, mais dont nos cartographies économiques actuelles sont incapables de nous faire prendre la vraie mesure. Autrement dit : l’axiomatique extractiviste poussée à son comble par le capitalisme boursier se trouverait avoir mis au point, avec la logique sociale de la dérivation financière, un mécanisme potentiellement capable de reconstruire une attention salvatrice à nos milieux naturels et sociaux [1].
La thèse de « l’auto-dépassement du capitalisme » (version du marxisme scientifique) ou du « socialisme du capital » (version opéraïste) n’est bien entendu pas nouvelle en soi. Elle sent même un peu trop l’auto-accomplissement de l’Histoire dans la dial