Sobriété énergétique, un nouvel oxymore ?
Longtemps utilisée pour désigner le fait de boire peu d’alcool, le mot sobriété renvoie de plus en plus à l’action d’économiser la planète et ses ressources. Initialement portée par les mouvements de la Décroissance, la notion de sobriété énergétique a émergé très lentement dans le débat public avant de s’imposer comme une évidence aujourd’hui. L’association NegaWatt, créée en France en 2001, a contribué à le diffuser en en faisant l’un des trois piliers de sa démarche, avec la promotion de l’efficacité et des « énergies renouvelables ». En 2010, un ouvrage à succès de Pierre Rabhi appelait à une « sobriété heureuse ».
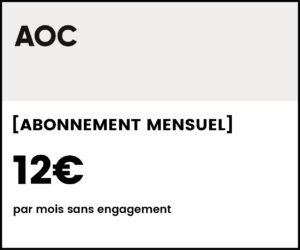
Les sciences humaines et sociales s’emparent également de ce sujet, alors que la sobriété énergétique a même été reconnue comme un objectif des politiques publiques en étant inscrite dans le premier article de la « loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte » votée en 2015.
Pourtant, la sobriété a des significations floues et ambiguës. Entre la réduction de nos consommations et la relance d’un projet productiviste et destructeur, le chemin est souvent tortueux. Pour beaucoup en effet, la sobriété est d’abord un contrefeu au « mot obus » de Décroissance qui suscite toujours le rejet. Si la sobriété implique une baisse de la consommation d’énergie, et donc une décroissance énergétique, la loi de 2015 l’associe quant à elle à un « mode de développement économique respectueux de l’environnement », mais également innovant et garant de la compétitivité des entreprises.
Dans ce contexte le mot risque fort de s’ajouter au long catalogue des oxymores qui prolifèrent depuis trente ans, comme le « développement durable » ou la « croissance verte ». La loi de 2015 annonce ainsi un objectif de 50 % de réduction de la consommation énergétique finale d’ici 2050, tout en réaffirmant la nécessité de soutenir « la compétitivité et le développement du secteur industriel », la loi « énergie-climat » de 2019 reprend globalement cet objectif, les g
