Se sentir en nombre
Que les régimes fascistes et nazi aient en plusieurs circonstances promu des architectures de compacité, c’est ce qu’a montré Miguel Abensour dans un texte pour la première fois publié en 1997. Ces architectures ne sont pas d’usage dans les pays dits démocratiques. Au reste dans ces pays, les partis ne recherchent plus les meetings autant qu’ils le faisaient et lors des campagnes électorales, ce sont des constructions bâties pour d’autres fonctions qu’ils utilisent ou aménagent provisoirement.
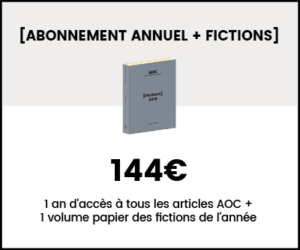
De leur côté les États, même les moins liés à l’idée de démocratie, redoutent bien plus souvent qu’ils ne souhaitent les grandes manifestations populaires. Ils préfèrent en général éviter les circonstances capables de rassembler d’importantes foules. Ce n’est pas que l’esprit de masse soit absent de la conduite des sociétés contemporaines, c’est qu’il se place ailleurs et autrement. La question est de savoir à quelles fins.
Observons d’abord combien persiste la sorte de nœud ou de nouage mental qui fige dans la figure de la masse ce qui peut être entendu par « peuple ». Imagine-t-on assez, à rebours, ce qu’est, pour l’essentiel, la mobilité d’un peuple ? Qui sait, dans un moment où le mot « territoire » est tellement d’usage, que « muant », « mutant », « migrant » ont la même vieille racine que « commun » ? Ce qui se rappelle là, quoiqu’on s’obstine à penser par ailleurs, c’est la vivacité foncière – commune – des peuples.
Ceux qui dès lors appellent à la mobilisation en pensant décupler ainsi l’énergie globale ne remarquent pas assez combien le registre du mot est ambigu. Dans l’état de guerre quand sont substitués aux allées et venues des peuples vifs et libres des marches au pas et des défilés en sens unique, il devient en tout cas patent que mobiliser, c’est moins rendre mobile qu’axer, assigner, fixer et, de la sorte, immobiliser, ou figer, les puissances de variations et de divergences de ceux qu’on mobilise.
De ce point de vue, la guerre, si c’en est une, dont a parlé
