La ligne de partage des couleurs – à propos de La ligne de couleur de W.E.B. Du Bois
“Le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs”. Cette citation pourrait être comprise comme étant celle d’un artiste. Or, elle est celle d’un sociologue africain-américain : William Edward Burghardt Du Bois, “le premier à produire des recherches quantitatives complexes sur les relations raciales ainsi que sur la population noire aux États-Unis”[1].
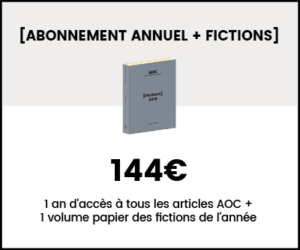
Cette ligne de partage des couleurs est donc celle imposée par le racisme et que Du Bois déconstruit en visualisant par des graphiques le développement de l’éducation dans les institutions noires et celui des communautés africaines-américaines du sud des États-Unis[2] depuis la fin de l’esclavage.
Ces graphiques, une soixantaine, firent l’objet d’une exposition, L’Exposition des Nègres d’Amérique, présentée lors de l’Exposition universelle, à Paris, en 1900. Ils s’organisent en deux corpus : le premier traduit une approche locale et s’intitule “Les Nègres de Géorgie, une étude sociale” ; le deuxième traduit, quant à lui, une approche globale et s’intitule “Une série de cartes et de diagrammes statistiques montrant la condition présente des descendants des anciens esclaves africains actuellement établis aux États-Unis d’Amérique”. Trois albums de photographies commandées à divers photographes noirs du Sud, ainsi que divers objets et deux cent cinquante ouvrages d’auteurs africains-américains, permettent de donner chair aux données abstraites. L’ensemble de ces documents constitue une réponse à “la question même de la visibilité des Noirs [qui se trouve] en effet au centre de la pensée de Du Bois.”[3]
Quatre textes placés en première partie de l’ouvrage sont écrits par cinq auteurs engagés dans les études sur l’histoire sociale et culturelle des Noirs américains. Ils resituent ces planches à la fois dans le contexte américain au tournant du XIXe et du XXe siècle, dans celui de l’exposition internationale, et dans une moindre mesure dans l’histoire du traitement graphique des données statist
