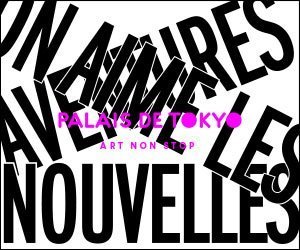Poètes à l’attaque ! (à propos de l’adaptation du premier livre de Houellebecq)
D’abord, il y a une voix : celle d’Iggy Pop, rauque et enveloppante à la fois, si grave et si profonde qu’elle semble être faite pour nous guider jusqu’aux enfers. Puis il y a les visages, filmés de près, comme si chaque accident, ride, marque, tressaillement étaient autant d’indices pour percer un mystère. Enfin des silhouettes se détachent, frêles ou massives, toutes différentes, bancales, fragiles, hors-norme. Des prénoms enfin, apparaissent : Anne-Claire, Jérôme, Robert – et puis un certain Vincent, sous les traits de Michel Houellebecq. Tous ont partie liée avec la folie, tous ont connu des « sorties de route », tous créent, avec des mots ou des pinceaux, pour pouvoir « rester vivant ».
L’art constitue-t-il, au fond de la souffrance, le seul moyen de survie ? Tout artiste est-il potentiellement un fou ? Tout fou potentiellement un artiste ? Jusqu’à quel degré de désespoir peut-on trouver en soi la force de créer ? Comment un poète peut-il survivre dans notre société ? Telles sont certaines des questions que posait le premier ouvrage poétique publié par Michel Houellebecq en 1991, intitulé Rester vivant. Méthode. Le poète s’y adresse directement au lecteur, il l’interpelle, il lui explique que si « le monde est une souffrance déployée », il faut se rappeler que « toute souffrance est bonne ; toute souffrance est utile » parce que « toute souffrance est un univers ». Souffrir n’est pas une fin, c’est une origine, c’est la source à laquelle il faudra, toujours, revenir : car « apprendre à devenir poète » déclare-t-il, « c’est désapprendre à vivre ». Et toucher le fond est la seule voie vers la rédemption : « Lorsque vous susciterez chez les autres un mélange de pitié effrayée et de mépris, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez commencer à écrire ». Erik Lieshout adapte très librement Rester vivant. Et il sous-titre son film ainsi : « Un feel good movie sur la souffrance ».
L’antithèse fait, évidemment, sourire. Elle est cependant pr