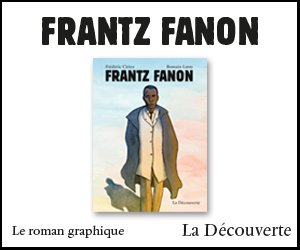Enseignements de Kanaky-Nouvelle-Calédonie : la force de la contre-histoire
Le 4 octobre dernier, les citoyens de Kanaky-Nouvelle-Calédonie se sont prononcés dans le cadre d’un processus démocratique unique dans l’histoire des décolonisations. En 2018, lors d’un premier référendum qui constituait la première étape d’une phase de consultation sur l’autodétermination, le pays avait vu la victoire du « Non » (53,7%) en même temps qu’une poussée inattendue du vote favorable à l’indépendance (43,3%). Deux ans plus tard, à l’issue d’une campagne dont les derniers jours ont donné le sentiment de la possibilité d’un basculement pour le « Oui », le « Non » l’a emporté avec 9970 voix d’avance, soit un écart réduit de moitié par rapport au précédent référendum.
Ce résultat, issu d’une impressionnante participation (85,7 %), est à appréhender d’un point de vue dynamique : la dimension qui semble aujourd’hui inéluctable de l’indépendance à court ou moyen terme, l’est d’autant plus qu’une telle situation était encore très improbable il y a 2 ans. Cet effet de surprise explique sans doute le ton inquiet qui domine parmi les commentaires et analyses (sur l’archipel comme en métropole), construisant le récit d’un contexte « bloqué » qui masque un processus historique dont chaque étape nous révèle au contraire un indéniable cheminement.
Le « vide » de cette situation présentée comme figée, qui inquiète tant, ne s’avère pas si vide que cela ou plutôt, il semble avoir été investi positivement par l’intention politique d’un peuple qui, d’une certaine manière, a bien repris la main sur le cours des choses après plus de 150 ans de colonisation.
S’il fallait une seule illustration de ce cheminement inexorable vers l’indépendance, dès le lendemain de l’annonce des résultats de la consultation du 4 octobre, l’un des partis historiques et jusqu’à récemment les plus influent du camp loyaliste, « Calédonie Ensemble », s’est prononcé publiquement pour « Construire un OUI COLLECTIF en conjuguant « Souveraineté » et « République » ».
Il s’agit d’interroger, à