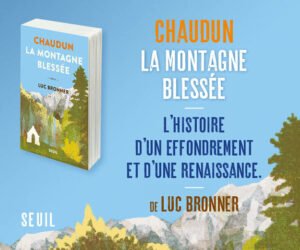L’État investisseur n’est pas forcément keynésien
Le discours économique actuel, qu’il émane du gouvernement français ou de la Commission européenne, est à la valorisation de l’investissement public. Alors qu’hier encore la dette était présentée comme le pire des fardeaux que nous pouvions laisser aux générations futures, peu importe aujourd’hui les sommes empruntées, il semble que l’essentiel pour l’avenir de nos enfants est d’injecter de l’argent dans l’économie. Nous vivons de fait une phase de dédramatisation de la dette et de revalorisation de la dépense publique.
Cette valorisation de l’investissement public ne date pas de la crise actuelle. Depuis le milieu des années 2010, de nombreux acteurs, pourtant peu réputés pour leur laxisme budgétaire, comme le FMI, l’OCDE et même la Banque centrale européenne (BCE), avaient commencé à plaider en ce sens. Ils s’alarmaient de l’inefficacité de la politique de création monétaire massive à relancer la croissance européenne qui rappelait, sous une autre forme, l’« anomalie » de la stagflation des années 1970 et faisait planer le risque d’une « stagnation séculaire ».
Ainsi, dès 2014, le président de la BCE, Mario Draghi, déclarait que la BCE « ne peut pas tout » et que la politique monétaire serait d’autant plus efficace qu’elle agirait « en soutien des financements publics ». Il appelait alors les gouvernements à utiliser l’« arme budgétaire » et à mettre en œuvre « un vaste programme d’investissement public » européen. Le Plan d’investissement pour l’Europe (dit Plan Junker) décidé par la Commission en 2015 – et reconduit depuis – ou les annonces de la nouvelle présidente de la Commission pour un « Green Deal européen » à l’automne 2019 répondent à cet appel, qui semble alors faire l’unanimité, y compris parmi les représentants de la plus stricte orthodoxie budgétaire comme Jean-Paul Trichet.
La France s’était montrée d’emblée favorable à cette inflexion du discours économique européen. Et pour cause : le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait déjà, à l’oc