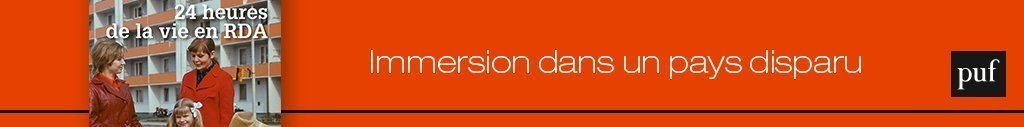Représenter les classes populaires – retour sur l’histoire du Parti communiste français
Il y a 100 ans, lors du congrès de Tours de décembre 1920, une large majorité des délégués du parti socialiste votaient l’adhésion à l’Internationale communiste. Progressivement, un parti de « type nouveau », érigé en « Parti de la classe ouvrière », s’est construit en forgeant des outils de lutte contre la monopolisation des postes politiques par les classes supérieures. Son histoire, que l’on retrace et analyse dans l’ouvrage récemment paru Le parti des communistes, met en évidence ce qui hante la démocratie libérale depuis le XIXe siècle : le défaut de représentation politique des classes populaires, un enjeu plus que jamais d’actualité.
La fabrique d’un parti ouvrier
En France, le Parti communiste naissant est d’abord essentiellement dirigé par des hommes de lettres et des enseignants. Les ouvriers sont initialement très peu nombreux dans une direction en grande partie héritée de l’ancien parti socialiste, qui était dominé par les élites intellectuelles (journalistes, avocats, enseignants).
Il faut attendre la phase dite de « bolchévisation » entamée en 1924-1925 pour qu’une direction ouvrière se mette progressivement en place. À cette occasion, les « éléments prolétariens » sont promus dans l’organisation, tandis que priorité est donnée à l’organisation dans les entreprises. Mis à l’écart, de nombreux dirigeants issus du parti socialiste, souvent des élus, laissent la place à des militants, plus jeunes et plus ouvriers, issus du syndicalisme. Pierre Semard, cheminot révoqué, ancien syndicaliste révolutionnaire, devient ainsi secrétaire général du parti durant l’été 1924. Maurice Thorez, qui a travaillé un temps comme mineur, entre au même moment dans la direction ; il sera le premier responsable du PCF de 1931 à 1964.
La constitution d’un parti ouvrier repose sur des mécanismes de sélection, de formation et de promotion des militants d’origine populaire. En relation étroite avec des intellectuels impliqués dans les activités d’éducation militante, la