Complot sans théorie, une expérience de pensée
Au moins depuis que les images de Jake Angeli – le « QAnon shaman » – ont fait le tour du monde pour illustrer l’assaut du Capitole, les diagnosticiens contemporains s’accordent à dire que la crise politique – pas juste états-unienne – est liée à la contagion pandémique de théories du complot. Le culte qui veut que des fonctionnaires démocrates américains dirigent un réseau pédopornographique connaît outre-Rhin un regain d’intérêt dans le mouvement dit des Querdenker [1], des « anti-conformistes ».
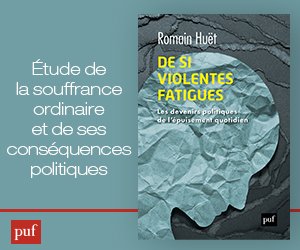
Croyance qui trouve facilement à s’hybrider à cette autre qui veut que la pandémie soit une machination de la Fondation Gates ou encore que les mesures politiques visent à instaurer une dictature mondiale. Comme si le virus ne s’attaquait pas qu’aux voies respiratoires et nerveuses mais aussi à la saine confiance dans le monde, une partie importante de la population connaît actuellement une perte de foi dans une réalité partagée, acceptée et officielle.
On en voit les conséquences jusque dans nos cercles d’amis : des connaissances qu’on estimait pour leur intelligence et leur circonspection se révèlent soudain être des « corona-négationnistes ». Entre une « évolution des contaminations », qui les dépasse, et des mesures sanitaires, qu’elles perçoivent comme une menace, difficile de se résigner à l’inévitable. Mais alors pourquoi se jeter dans le terrier du lapin, croire en un complot, se référer à des faits douteux ? Nous connaissons les ressorts des « infox » et autres « pièges à clics » sur les réseaux sociaux. En parallèle, les premières études se sont penchées sur les indicateurs psychosociaux de la pensée paranoïde. Mais au-delà de tout cela, qu’est-ce qui lie l’essor des théories du complot à la situation actuelle ? Qu’est-ce que cela nous dit de l’état d’esprit de l’époque ?
Tentons une petite expérience de pensée : prenons une de nos connaissances rongée par le doute et replaçons-la dans le contexte ouest-allemand de la fin des années 1960. Dans un premi
