Le Grand écrivain, cette imposture française
Le Grand écrivain n’a toujours été qu’une vaste supercherie. Tel serait, aussi brutal qu’indépassable, le postulat qui présiderait au destin de celles et de ceux qui, hier comme aujourd’hui, entendent devenir, être et incarner au plus fort d’eux-mêmes ce désir flamboyant de gloire : être le Grand écrivain de son temps.
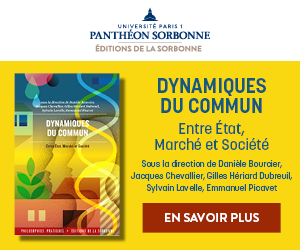
Depuis son apparition à l’entame du XIXe siècle, porté par la fougue du romantisme, jusqu’à notre contemporain le plus extrême avec Emmanuel Carrère ou encore Michel Houellebecq, le Grand écrivain ne se tient parmi nous qu’à la manière d’une imposture sans fard et sans vergogne. Une terrible supercherie sociale, politique et littéraire qui, dans un esprit toujours belliqueux, pousse à voir et à faire percevoir le monde à l’aune d’un culte déraisonnable des Grands hommes. Car le Grand écrivain est cet homme qui, de lui-même, depuis son intime décision, a décidé de devenir Grand, de s’inventer Grand et de se fabriquer Grand.
À ce titre, le Grand écrivain s’affirme sans faiblir comme celui qui, rêvant à voix haute d’une science méthodique du charisme, force à chaque instant le sublime en lui. C’est comme s’il entendait devenir métaphysique de son vivant. Dès lors, il faudrait peut-être le dire sans attendre : si le Grand écrivain désire atteindre à la mythification de soi, peut-être est-ce uniquement à la faveur d’une mystification concertée.
Qui ne se souvient effectivement pas des célèbres pages de Sartre dans son petit manuel du Grand écrivain que sont Les Mots où, de manière si juste et si pénétrante, il met à nu son désir fou d’être écrivain, un désir d’écrire qui se mesure à l’aune de la Grandeur et de la supercherie ? Qui n’a ainsi pas en mémoire ces quelques réflexions où Sartre lance que « la fréquentation des grands hommes m’avait convaincu qu’on ne saurait être écrivain sans être illustre » et que, partant, confesse-t-il, « j’écrivais par singerie, par cérémonie, pour faire la grande personne » ? Et, de fait, est-ce que ne se donne p
