Cent mille vies
Nous avons franchi jeudi 15 avril 2021 la barre symbolique des cent mille morts de l’épidémie de coronavirus. Aux États-Unis, où l’on compte désormais plus de cinq cent mille victimes, ce seuil a été atteint dès le mois de mai 2020. Le New York Times avait alors mis en une du journal une liste impressionnante de mille noms, imprimés en tous petits caractères, pour donner une idée de ce que représentait humainement cette « perte incalculable [1] ».
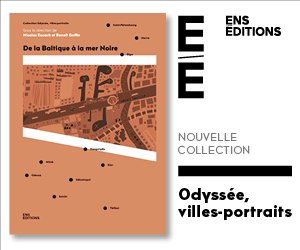
Parce qu’« ils n’étaient pas simplement des noms sur une liste », les journalistes ont trouvé pour chacun d’eux, en guise d’épitaphe, quelques mots extraits des nécrologies parues dans des dizaines de journaux du pays :
Irvin Herman, 94 ans, Indianapolis, ancien de la marine qui ne se vantait pas de son service dans le Pacifique. Louvenia Henderson, 44 ans, Tonawanda, fière maman de trois enfants. Jesus Roman Melendez, 49 ans, New York, célèbre dans sa famille pour son ragout de boeuf birria. Joe Diffy, 61 ans, Nashville, star de la country récompensée aux Grammys. Ronnie Estes, 73 ans, Stevensville, voulait toujours être près de l’Océan…
Dans le cadre de cet hommage, le Grammy vaut autant que le ragoût de bœuf ou la passion de l’océan : il est simplement l’une des qualités grâce auxquelles on perçoit que chaque vie vaut que l’on s’en souvienne. Les quelques mots qui évoquent une profession, un trait de caractère, une manière d’être heureux ou la fierté d’être mère tentent de conjurer tant l’anonymat des statistiques que le bloc de silence des noms propres.
Mais le New York Times n’avait pas attendu ce seuil des cent mille morts pour donner un visage aux victimes de l’épidémie. Dès le mois de mars 2020, au moment où le coronavirus explose sur la côte Est des États-Unis, le service des nécrologies du journal se réunit pour imaginer les manières de réagir au désastre annoncé. Ce sera la rubrique « Ceux que nous avons perdus » (« Those we’ve lost »), inspirée des quelques 2500 « Portraits de la douleur » (« Portrait
