Apprendre à penser global (et pas universel) – un moment latourien (4/4)
Le quatrième geste théorique de Latour qui le rend particulièrement pertinent pour penser le temps présent est d’avoir fait de la globalisation la grande question à la fois épistémologique, morale, politique et métaphysique qu’il faut affronter. La Modernité est obsédée par la question de l’universalité, notamment dans son opposition aux différences : ce fut toute la problématique des droits humains, de la citoyenneté, de la religion même, de la laïcité encore chez quelques esprits lents…
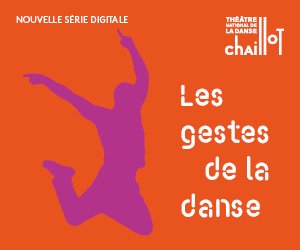
Latour, quant à lui, n’a cessé d’expliquer que derrière les phénomènes d’universalisation se trouvaient en vérité des processus de globalisation et que ceux-ci posaient des problèmes autrement plus intéressants et pertinents que ceux-là. On peut distinguer universalisation et globalisation, en disant que la première met en œuvre l’opposition de l’identique et du différent, alors que la seconde met en œuvre l’opposition du partiel et du total.
La grande question contemporaine n’est pas de savoir comment se fondre dans une identité, mais comme se composer dans une totalité. Or, sur ce point, une fois de plus, la pandémie de Covid-19 est venue confirmer la pertinence de l’approche que Latour défendait.
Ce déplacement vers la question de la globalisation, Latour en a d’abord éprouvé la nécessité pour les sciences : à l’énigme de la vérité universelle des énoncés scientifiques, Latour répondait par la proposition d’étudier la construction de réseaux réels qui permettent la circulation des énoncés dans des ensembles toujours plus grands [1]. Si les lois de Newton sont universellement vraies, c’est qu’il existe des instruments d’observation, de calcul, de mesure, qui permettent de rapporter certains événements à ces énoncés, littéralement comme on transporte un fragment de quelque chose d’un lieu à un autre.
Dire que tout événement obéit par nature aux lois de Newton n’a pas plus de sens que de dire que la chute de ma tartine sur le carrelage est en soi un événement scientifique
