De Barkhane au développement : la revanche des contextes
Lutter contre le jihadisme au Sahel est indispensable, tout le monde en convient. Mais c’est une lutte particulièrement complexe. En un sens, il s’agit d’une politique publique, qui a un volet sécuritaire important (militaire et/ou policier), contrairement à beaucoup d’autres politiques publiques, mais qui a aussi, comme beaucoup d’autres politiques publiques, un volet socio-économique (fournir des emplois ; délivrer des services publics de proximité) et un volet politique (un Etat impartial et une gouvernance satisfaisante). Les trois volets sont à l’évidence complémentaires.
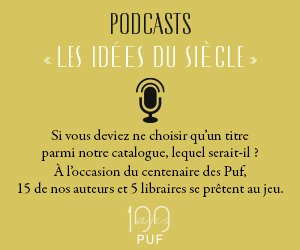
Qu’il faille une politique publique fondée sur ces trois volets fait à peu près l’unanimité chez les experts. La récente décision d’Emmanuel Macron de retirer la force Barkhane du Mali montre que le volet militaire est dans une impasse sous sa forme actuelle (une opération extérieure française), tout comme d’ailleurs le volet politique (le double coup d’état militaire révélant plus encore la faillite de l’Etat malien, ou plus exactement de sa classe politique).
Le seul point sur lequel tout le monde semble s’accorder, c’est sur le fait que le volet socio-économique serait la clé ultime. Autrement dit, c’est avant tout le développement qui sauverait le Sahel de la catastrophe jihadiste.
Pourtant, paradoxalement, le développement tel qu’il est mené au Sahel (depuis fort longtemps) souffre du même mal profond qui a handicapé l’opération Barkhane : tous deux ont pour particularité première d’être des interventions conçue, pilotées et financées essentiellement de l’extérieur. Nous examinerons ici comment l’intervention militaire française et les interventions développementistes/humanitaires internationales se heurtent à la même « épreuve » de contextes locaux qu’ils méconnaissent, épreuve qui tourne souvent à la « revanche » de ces contextes. [1]
Quant au volet politique, il pose d’autres problèmes, fort complexes eux aussi, mais d’un tout autre ordre, dans la mesure où, malgré les pressi
