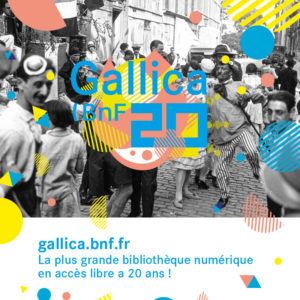Service militaire, retour vers le futur
L’institution du service militaire personnel obligatoire a été un pilier du modèle républicain à partir de la Troisième République. Auparavant, sous la forme de la conscription, le service fut, dès les commencements du XIXe siècle, un des principaux instruments de l’État-nation centralisateur et en même temps un moyen d’achever l’unité de la nation française.
Les Français ont entretenu avec lui des rapports passionnels, mêlés tout-à-la fois d’idéalisation et de résistance. À ce titre, pendant à peu près deux siècles, il a fait l’objet de débats, tant au Parlement que dans l’opinion publique. C’est le consensus autour de sa suppression par la loi du 28 octobre 1997 (ou du moins l’absence de discussion à son propos) qui est exceptionnel. D’ailleurs, lorsqu’il a été supprimé de fait, cette suppression n’a pas été avouée comme telle, et le législateur a préféré employer dans le texte de loi le mot de suspension, pour ne pas être accusé de porter atteinte au modèle républicain lui-même.
Très vite, le débat a ressurgi à son propos. C’est d’ailleurs à partir des années 2000 et surtout de la crise des banlieues en 2005, et dans un contexte d’anomie sociale, que la disparition du service – et non la professionnalisation de l’armée – a été déplorée. Avant les élections présidentielles de 2007, les futur.e.s candidat.e.s évoquent le sujet. Des substituts sont cherchés, principalement en 2010 quand, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est créé le service civique. Mais destinée seulement à des volontaires, cette création, certes étendue sous la présidence de François Hollande, laissait en suspens la question de la cohésion sociétale qu’aurait permis le brassage de tous les jeunes gens effectué par l’ancien service. D’où la proposition du futur président Emmanuel Macron pendant la campagne électorale de 2017 de fonder – ou de refonder – un service qui reprendrait le qualificatif de militaire. Finalement, c’est à l’élaboration d’un service national universel que l