Tour de France : sans Blondin, comme des singes en hiver
« Depuis 1789, le mois de juillet paraît bien futile, on n’y prend plus que des châteaux de sable. Le Tour est donc utile : il entretient des couleurs épiques, qui, sans lui, ne seraient plus de saison. »
Il y a trente ans disparaissait Antoine Blondin (1922-1991), écrivain flamboyant et suiveur éternel de l’Académie du Tour de France.
« On prend toujours le Tour de France en marche. Il vous accueille mais on le reçoit, comme une sorte de sacrement, un baptême ou une communion si l’on veut, avec le sentiment d’émarger à un grand système qui vous dépasse. (…) À des journalistes américains qui lui demandaient ce qui l’étonnait le plus aux U.S.A., Marcel Aymé répondit naguère : “C’est de m’y trouver.” Ainsi le premier étonnement vient-il d’appartenir enfin à cette caravane qui décoiffe les filles, soulève les soutanes, pétrifie les gendarmes, transforme les palaces en infirmeries ou salles de rédaction, plutôt qu’à ces conglomérats de gamins confondus par l’admiration et chapeautés par une marque de biscuits. Au vrai, la seule ombre portée sur cette initiation est de ne pouvoir se regarder passer soi-même. »
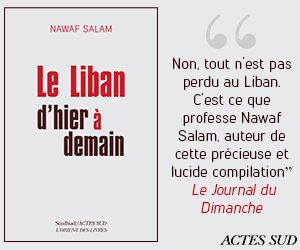
Nos présidents en perpétuelle recherche de popularité n’échangeraient d’ailleurs pas la place qui leur est traditionnellement réservée dans la voiture du directeur de course contre les commandes d’un char Leclerc, un matin de Fête nationale, sur les Champs-Élysées. Seul le Général préféra la position du spectateur qui attend le peloton là où il lui a fixé rendez-vous, c’est-à-dire devant sa porte : il n’avait sans doute pas échappé à cet autre grand littéraire que durant ce temps suspendu qui précède la volée des coureurs, chaque village qui a la chance de se trouver au bon endroit sur la carte se transforme en capitale de l’euphorie comme dans l’attente de ses libérateurs.
Depuis, une sorte de pacte a été scellé entre la Monarchie de Juillet et la République, qui voit, chaque année, ces suiveurs d’un jour, mais suiveurs toujours, se muer en chef d’étape,
