La fabulation spéculative, de Zanzibar à Balard
La fabulation spéculative a une longue histoire. Traduit en 2020, Vivre avec le trouble [1] permet de mesurer le chemin parcouru depuis l’invention du concept il y a trente ans. Depuis les années 1990, à l’intersection entre philosophie des sciences et féminisme, la philosophe Donna Haraway s’y attache à mettre en évidence comment la science moderne s’est appuyée tout au long de son histoire sur des mythes, tout en prétendant n’être que des « miroirs fidèles de la réalité [2] » et en rejetant la fiction dans le domaine mineur du divertissement. Ainsi, Donna Haraway montre comment la primatologie, la discipline qui étudie les ancêtres proches de l’espèce humaine, s’est appuyée sur le mythe de « l’homme-chasseur dominant [3] », un cadre culturel (et largement fictionnel) qui a orienté la recherche sur les grands singes et son usage politique.
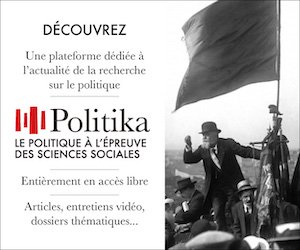
Toutefois, plutôt que de remettre en cause la science dans son entièreté, Donna Haraway propose de reconnaître que les savoirs scientifiques sont situés, afin de les ouvrir à d’autres points de vue et d’autres fins – autrement dit, le fait que « les savoirs scientifiques soient des tissages inextricables de faits et de fictions » n’appelle pas tant à disqualifier la science qu’à investir l’espace de la fiction en son nom.
Et pas n’importe quelle fiction ! Car tout l’enjeu de Vivre avec le trouble réside dans la caractérisation des nouvelles fictions à créer. Donna Haraway s’insurge contre les mythes dominants des héros conquérants, qui ont orienté la connaissance moderne tout en ayant partie liée avec le « patriarcat blanc capitaliste », pour reprendre l’expression utilisée dans le Manifeste Cyborg. Elle appelle au contraire à inventer des récits depuis la perspective des femmes, des non-valides, des peuples colonisés, du vivant non-humain, bref : depuis la perspective des « cyborgs », la métaphore qu’elle emploie pour désigner des êtres insaisissables, non-binaires, ni entièrement humains, ni entièrement animaux.
Face
