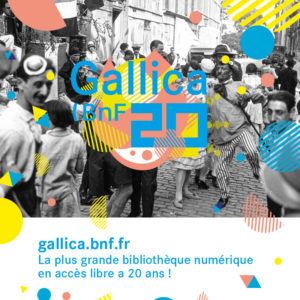L’Europe, un enjeu de luttes entre classes sociales
À l’approche des élections européennes de 2019, un même paradoxe se profile dans la plupart des pays membres : alors que les scrutins nationaux ont pour principal enjeu le positionnement par rapport à l’Union européenne (comme l’ont montré l’élection présidentielle française ou les dernières législatives italiennes), les occasions de choisir celles et ceux qui siègeront à Strasbourg suscitent chez la majeure partie des citoyens européens, au mieux l’indifférence, sinon l’exaspération.
Les victoires du « non » aux référendums français et néerlandais de 2005 sur le traité constitutionnel, la crise de la dette grecque en 2010 et la victoire du Brexit en juin 2016 ont bien montré que le clivage entre partisans et adversaires de la construction européenne est devenu incontournable. Mais ces débats sont toujours analysés comme autant de révélateurs du nationalisme, sans que la question des effets de la construction européenne sur les inégalités puisse être véritablement discutée, faute de disposer d’instruments de mesure des classes sociales à l’échelle du continent.
Désormais, les rapports entre classes sociales se jouent, pour partie, au niveau européen et non plus seulement dans le cadre national.
Qu’est-ce qui rapproche et distingue le fameux plombier polonais d’un cadre supérieur roumain ou d’un ouvrier français ? Désormais, les rapports entre classes sociales se jouent, pour partie, au niveau européen et non plus seulement dans le cadre national. La circulation des capitaux économiques, des biens culturels et symboliques dépasse les frontières : les migrations de travailleurs, d’étudiants et de touristes, impliquent, pour des millions de citoyens européens, une expérience directe et concrète des rapports de classes à l’échelle du continent. Le capitalisme européen met non seulement en concurrence des ouvriers par le biais des délocalisations et du travail détaché, mais aussi des patrons et des cadres amenés à réorganiser les conditions de travail dans les