Signification et limites de la décroissance
Si la décroissance ne consistait qu’à produire et à travailler moins, elle serait une impasse à l’heure où la conversion de notre système productif, la transition des systèmes de transports, de l’agriculture, des modes de chauffage, de l’habitat et de l’urbanisme, les travaux de « fermeture » des industries extractives et de restauration des sites dévastés, demandent des investissements et des efforts accrus. Plus que la décroissance, n’est-ce pas la transformation du système productif qu’il convient de mettre en œuvre ?
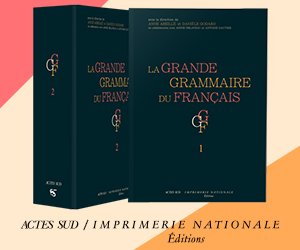
Il s’agit d’organiser non la décrue quantitative, mais la réorientation qualitative du système productif. La notion de décroissance a néanmoins le mérite d’interroger en creux ce qu’est la croissance. L’économie et le système productif qu’elle anime constituent non seulement une machine, mais transforment la société en machine en vue de la mobilisation totale des êtres humains et des biens, ainsi que du « développement de marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie », selon les termes mêmes du Traité de Lisbonne. On en appelle, pour assurer la conversion énergétique, à la sobriété et à la conversion morale de l’homo œconomicus, mais la plupart de nos dépenses sont commandées par les besoins de la machine et de son fonctionnement.
Ce n’est pas l’individu mais la mégamachine économique et productive, qui a des besoins, que les êtres humains se contentent d’éprouver au nom précisément du bon fonctionnement de la machine, de sorte que l’individu n’est plus maître de déterminer lui-même ni le niveau de ses besoins ni l’effort qu’il est prêt à fournir pour les satisfaire. C’est sans doute pour avoir sous-estimé la dépendance des êtres humains à la machine économique et productive, pour avoir cherché à contraindre nos mœurs sans la moindre volonté de réformer la machine qui les commande, que le précédent gouvernement a déclenché le mouvement des Gilets Jaunes.
La croissance est donc essentiellement l’expression du bon
