Du « welfare state » au « corporate welfare » ?
«Vous avez besoin d’argent, je vous en donne », n’a cessé de répéter aux chefs d’entreprise Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, tout au long de l’année 2020. « C’est dans ces moments de crise qu’il faut profiter de l’argent de l’État », leur a-t-il même dit[1]. « L’argent magique », qui n’existait pas, pouvait finalement couler à flots. Pour qui s’était habitué à voir Bercy rechigner à dépenser chaque million d’euros, les chiffres peuvent donner le tournis : 240 milliards d’euros d’aides publiques au secteur privé en moins de 18 mois. Soit plus de trois fois le budget de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ou presque six fois celui de la Transition écologique[2].
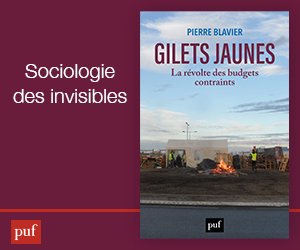
Depuis le début de la pandémie, Bercy, rétif à la dépense, a donc donné l’impression d’avoir tourné casaque : l’unité de compte est devenue le milliard d’euros, à dépenser aussi vite que possible. Près de 140 milliards ont ainsi été engagés sous forme de prêts garantis par l’État, 35 milliards pour le fonds de solidarité pour les entreprises, 35 milliards pour le chômage partiel (dont un tiers pris en charge par la sécurité sociale), ou encore 10 milliards d’euros d’exonérations de cotisations et d’impôts. Sans même parler du plan de relance et des plans sectoriels, ni du plan France 2030 à venir. Le « quoi qu’il en coûte » n’était donc pas qu’un mot en l’air. Pour certains commentateurs, il illustre même le retour de l’État interventionniste.
Il n’est pas ici question de mettre en doute la pertinence de soutenir le secteur privé à partir du moment où les pouvoirs publics décidaient de confiner le pays et arrêter certaines activités économiques. En plus d’être justifiées, des politiques contra-cycliques, comme les appellent les économistes, étaient nécessaires. Néanmoins, constater que les robinets sont ouverts ne suffit pas à caractériser une politique. Encore faut-il savoir qui en est bénéficiaire (et qui ne l’est pas), dans quel but et à quell
