Haïti, de l’État marron à l’État failli
Sa situation de perpétuelle survie dans la tempête a fait d’Haïti un État particulier à de multiples égards. Dans la longue durée, trois moments ont été déterminants dans le profilage des institutions et du rapport des individus à l’État.
Ces moments fondateurs permettent de suivre et de comprendre la genèse de l’État Haïtien : le passage de l’État marron à l’État autoritaire puis à l’État failli constitue la trajectoire de l’État en Haïti. Passage effectué non à la manière de mues successives, mais comme un emboîtement d’oripeaux chaque fois plus contraignants pour le citoyen. Cela s’est traduit sur le plan géographique par une segmentation du territoire en marges dispersées autour d’un axe utile allant de Port-au-Prince aux deux extrémités des presqu’îles, avec un gradient d’intensité dans les échanges qui décline à mesure que l’on s’éloigne de la capitale.
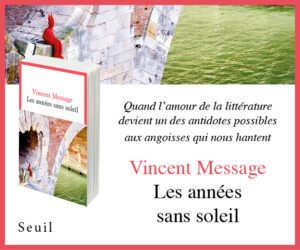
Haïti est le pays le plus pauvre du Nouveau Monde. Cette affirmation revient comme un leitmotiv dans les analyses, dès lors qu’il est question d’économie, de gouvernance et de performance financière.
Cette image d’Épinal de pays à la traîne, si elle est un peu forcée, confirme un bilan globalement alarmant de la gestion des affaires publiques, tant les conditions économiques et sociales continuent de se dégrader au fil des générations. Tous les indicateurs le prouvent : par le PIB, par les taux de natalité infantile et l’espérance de vie, par la proportion de pauvres dans la population et par le manque d’investissements directs de l’étranger, Haïti se distingue du reste de la Caraïbe, toujours en pire.
Et pourtant, ce pays fut autrefois considéré comme la Perle des Antilles dans une région qui bénéficie de la proximité du plus vaste marché de la planète. À une échelle plus fine, on s’avise que le potentiel est encore grand : les ressources sont le plus souvent inexplorées ou inexploitées. Le pays importe les biens qui faisaient autrefois sa richesse et sa force : le sucre et le café. Les autres pays d
