Que sont devenues les sorcières en 2021 ?
À la fin du mois d’août 2021, alors que l’été se termine doucement, Sandrine Rousseau, candidate à la primaire des écologistes pour la présidentielle 2022, a évoqué la sorcellerie. En réponse à la question de Charlie Hebdo, « Jusqu’où peut aller l’écoféminisme ? », elle répond : « Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. » La réponse fait le buzz, les journalistes politiques ne comprennent plus rien et sa candidature est lancée dans un parfum de scandale. Comment des femmes pourraient-elles jeter des sorts dans la réalité ?
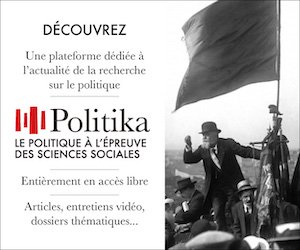
Depuis quelques années, les sorcières sont devenues, plus qu’un simple objet de curiosité, un champ dont l’étude produit de nouvelles connaissances et des perspectives inédites qui éclairent l’histoire des femmes, en particulier en Europe à l’aube de la modernité. Cet intérêt aigu est étonnant. Les sorcières résident surtout dans toutes sortes d’histoires, leurs vies sont plus fictives que réelles tant elles désignent un pouvoir surnaturel lié à un pacte avec le diable.
Pourtant, les sorcières de la Renaissance ne nous ont jamais autant captivé, et avec un grand sérieux. Cette culture considérée comme résolument magique ne peut être séparée d’un mouvement plus vaste de critique de la raison occidentale dans son projet techniciste de maîtrise de la nature. Les sorcières reviennent donc hanter nos jours et nos nuits parce qu’elles participent de la recherche d’autres modes d’organisation du vivre-ensemble, d’une volonté de renouer des liens souvent distendus entre humains et non-humains, et cela dans le cadre d’un refus des politiques prédatrices des multinationales, de l’exploitation capitaliste sans fin des ressources de la planète. Les violences faites aux femmes et les violences faites à la nature révèlent des mécanismes communs, troublants.
On lit plus que jamais les livres sur les chasses aux sorcières pendant la Renaissance, et surtout on prolonge cette histoire en soutenant que le
