Pour une réécriture de l’état d’urgence
La loi du 10 novembre 2021 a prolongé jusqu’au 31 juillet prochain le régime « provisoire » dit de « sortie d’état d’urgence sanitaire ». C’est la cinquième fois en un peu moins de deux ans que les parlementaires entérinent la décision du gouvernement, avec la caution du Conseil constitutionnel. Celui-ci a retoqué quelques rares mesures – celle, par exemple, permettant aux directeurs d’établissements scolaires d’avoir accès aux informations médicales des élèves et de les « traiter » sans devoir obtenir préalablement leur consentement[1] – mais il n’a jamais remis en cause le principe même du recours à un régime d’exception, ni la possibilité de le proroger indéfiniment.
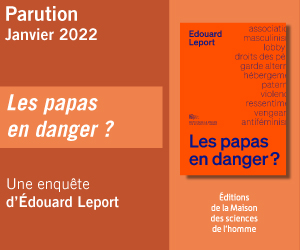
Les noms donnés aux textes ne doivent pas nous leurrer. Qu’il s’agisse de lois « prorogeant » l’état d’urgence ou de celles « organisant » sa « sortie », le régime et ses modalités d’application demeurent inchangés. Nous vivons en état d’urgence sanitaire permanent depuis le 23 mars 2020, de même que nous avons vécu en état d’urgence sécuritaire – dont de nombreuses mesures ont finalement été intégrées au droit commun – entre 2015 et 2017. Et puisqu’il n’existe aucun garde-fou institutionnel, rien n’indique que nous en sortirons en juillet 2022, à moins que la majorité issue des prochaines élections générales ne le décide. Mais dans un contexte de regain de l’épidémie et de pré-campagne électorale focalisée sur les questions d’identité et de sécurité, rien n’est moins sûr.
La crise que nous traversons doit nous faire réfléchir à la manière dont l’exécutif fait et défait le droit dans l’urgence, en quelques jours à peine. Certains diront que cela est nécessaire, d’autres que cela est même salutaire au nom du droit à la santé – que le Conseil constitutionnel a érigé en objectif à valeur constitutionnelle[2]. Mais tout cela est dangereux pour l’État de droit, dont l’érosion s’est accélérée à une vitesse inouïe ces vingt dernières années. Pour réfréner le phénomène, quoi de mieux que de réforme
