Il faut bien comprendre François Fillon…
Fin novembre s’est achevé le procès en appel du couple Fillon. Les griefs contre l’ancien premier Ministre et sa désormais célèbre épouse sont bien connus. Le tribunal accuse le premier d’avoir octroyé plusieurs emplois fictifs à la seconde : dès les premières années de son mandat de député, en mai 1981, et de façon régulière dans les trente années qui ont suivi, Pénélope Fillon aurait perçu des salaires, parfois élevés, pour une activité dont la réalité est mise en cause par la cour.
Le tribunal s’intéresse aussi à l’embauche par l’ancien premier Ministre de deux de ses enfants comme collaborateurs ponctuels lorsqu’il était sénateur. Ces derniers auraient ensuite été invités à lui restituer les salaires perçus afin de rembourser, par ce qu’il décrit comme un petit boulot d’été, divers frais engagés par le couple – de mariage pour l’une, d’études pour l’autre.
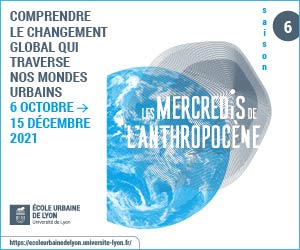
C’est peu dire qu’on a beaucoup écrit sur cette affaire. Les révélations ont ponctué la campagne présidentielle de 2017, allant jusqu’à empêcher l’accession au second tour d’un candidat que beaucoup voyaient élu. Depuis, l’affaire Fillon est devenue un symbole. Il faut dire que les informations illustraient parfaitement un cliché bien installé à propos des responsables publics : ils seraient intéressés, d’abord engagés en politique pour s’enrichir. C’est encore plus le cas pour les « professionnels de la politique », dont François Fillon était, avec ses quarante années de vie publique, perçu comme l’incarnation.
L’« affaire » a donc beaucoup fait parler d’elle. On a aussi beaucoup disserté sur l’immixtion de juges dans une campagne électorale, sur la légalité et la moralité d’employer un conjoint. On a enfin beaucoup glosé sur la psychologie du personnage, décrit à la fois comme secret et vénal, cupide et obstiné.
On a par contre bien moins souvent tenté de comprendre François Fillon et son comportement. On n’a pas cherché à faire sens de ses actions ; à savoir d’où venait ce sentiment d’injustice qu
