« Brosser l’histoire à rebrousse-poil » – sur la cancel culture
« Tout vainqueur des temps passés a sa place dans le cortège triomphal qui, guidé par les dominateurs du jour, foule aux pieds ceux qui gisent sur le sol. Comme cela a toujours été le cas, ce cortège charrie le butin. On appelle celui-ci “patrimoine culturel”. […] Et pas plus que du témoignage lui-même, la barbarie n’est absente du processus qui l’a transmis de l’un à l’autre »[1].
Bien souvent conçu comme exempt de toute forme de tensions internes, de contradictions sociales ou idéologiques, tout discours historiographique est le fruit de la conjoncture dans laquelle il émerge, de ses rapports de force et d’une tradition instituée de l’histoire marquée par l’imaginaire d’une période antérieure[2]. En ce sens, il est tout à fait cohérent qu’il produise, par son historicité même, des contre-discours mettant en lumière ses propres points d’ombre, ses partis pris épistémologiques, voire idéologiques, et son impensé collectif[3].
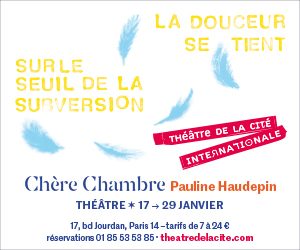
La mise au jour, dans ces contre-discours, de l’asymétrie de condition dans les processus historiques est souvent considérée comme un révisionnisme historique et culturel ou, pour reprendre les termes d’un courant idéologique davantage ancré dans une pensée dominante qu’il y laisse paraître, comme une forme de « cancel culture ». La posture victimaire de ce courant « anti-cancel », posture par ailleurs récurrente lorsqu’un groupe dominant se sent menacé, est fondée sur le postulat très classique d’une conservation patrimoniale figée en réaction à de prétendues stratégies d’effacement.
La peur d’un remplacement culturel relève bien plus souvent d’un fantasme et d’une construction de ses propres détracteurs – défenseurs d’une conception paradoxalement anhistorique et non axiologique du discours historique – que d’une intention avérée de groupes sociaux dominés réclamant visibilité et reconnaissance publiques. Les cas des histoires matrimoniales, sociales et décoloniales sont révélateurs en ce qu’ils font constamment l’objet de suspicion
